-
Compteur de contenus
2 123 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
72
Type de contenu
Calendrier
Profils
Forums
Blogs
Galerie
Articles
Variétés
Breeder
Grow Report
Smoke Report
Produits
Marque
Guides
Messages posté(e)s par Ex-UFCM-I Care
-
-
yeah man
hahahahaha
-
Hey
et si on revenait au fondamentaux .....
Good SEEDS

-
Hey
Bon bah Manuel pour être sur de pas déformer tes propos je copie colle tout ton com j'espere que tu vas pas me dire qu'il faut que je mette tout tes coms de cette discussion mais bon (joke c'est pas méchant
 )
)
"
yo .
Le 13/02/2018 à 15:59, UFCM-I Care a dit:je n'ai pas déformé tes propos, j'en avais juste extrait une partie
ouai , en coupant des morceaux de phrases on peut faire dire ce qu'on veut à qui on veut , et même avec la phrase complète si tu fais abstractions de toutes les phrases qui suivent ...
Comme le fait que plusieurs fois j'ai affirmé la valeur de la science , de la médecine moderne et que en aucun cas un système ne pouvait se substituer à un autre.
c'est quand même étrange que d'un côté tu fasse des articles sur les enthéogènes, et que de l'autre tu ne pense la thérapie qu'a travers des produits standardisés,
à ce moment là faudrait préciser dans les articles que les shamans se plantent complètements, et que tous les témoignages de patients c'est du pipeau.Le 13/02/2018 à 15:59, UFCM-I Care a dit:95% des médicaments présentent donc des risques ....??? sur quelles bases statistiques ou scientifiques sérieuses tu te bases ??
c'est juste un chiffre au hasard pour dire qu'une grande majorité des médicaments présente des risques , parceque oui des aspirines ont une dose létale , comme les anti-douleur à base d'opiacés, ce qui n'est pas le cas du cannabis ,
moi je trouve plus dangereux les gens qui se gavent de paracétamol et se font des trous dans l'estomac ou sont addict au somnifères, xanax... qu'une personne qui se fait une vape avec une fleur, poussé chez lui où ailleurs , il risque quoi ?
( et je précise puisqu'il est bon de tout préciser , je parle d'une personne adulte, majeur et responsable dont le cerveau est formé et aussi qui n'est pas allergique au cannabis , et qui à essayé d'autres formes de thérapie qui ne lui convienne pas )
édit / yop @Baron Vert , pourquoi un smiley triste ? le débat est une bonne chose je trouve , même si j'arrive pas à me f'aire comprendre et que je passe pour un junky irresponsable
, même si j'arrive pas à me f'aire comprendre et que je passe pour un junky irresponsable  "
"
je crois que tu ne comprend pas ce que je veux dire et me mettre en face du topic sur les autres plantes comme si c’était incohérent je trouve ça très moyen ....
Donc ah bah si tu vois j'ai été voir un chaman pour qu'ils me fassent un cocktail de plantes pouvant remplacer mon traitement, le problème c'est que c'est pas possible, ils peuvent en remplacer une partie mais aucune plante n’empêche la réplication du virus du sida dans les cellules .... donc obligé de m’accommoder des deux .... tu vois en final je suis très cohérent avec ce que je dis et ce que je vie .....
je suis d'accord je trouve aussi que l'utilisation du paracetamol est un vraie problème, mais pas que .... la malbouffe aussi .....
Après on ne parle peut etre pas de la même chose, tu parles peut être (je ne sais pas c'est une supposition) d'usage thérapeutique, moi je parle d'usage médical dans un cadre médical, d'ailleurs après que j'ai obtenue la recette des chaman j'ai ete voir une professeure en Pharmacognosie qui travail avec le CNRS et je lui ai demandé de valider la recette en question .... ce qu'elle a fait ....
voila j’espère que tu comprend mieux et mon positionnement et mon questionnement et aussi que je ne crache pas sur big pharma parce que malgré tout les défauts qu'on peu leur trouver il reste que de nombreuses personnes dont je fais parti les remercient d'etre encore en vie ..... (même si sans cannabis je peux pas prendre leur putain de medocs de merdeuuuuuuuuuuu hhahahahahaha)
animalxxx le sativex est en pharmacie en tant que médicament il y a une AMM et c'est un medoc breveté, les fleurs de weed que tu ne trouve pas dans tous les lands sont elles uniquement vendu (et même si il y a une ordonnance) comme des compléments alimentaires.
@+
-
 1
1
-
-
Salut
L'Artemisia annua et la valeriane.
hop ça c'est fait
@+
Absinthe chinoise
Connue depuis plus de 2 000 ans, en Chine, pour ses effets contre le paludisme, l'absinthe chinoise est encore utilisée aujourd'hui pour bien d'autres vertus médicinales.
 Nom scientifique : Artemisia annua
Noms communs : absinthe chinoise, armoise annuelle
Noms anglais : sweet annie , sweet wormwood , sweet sagewort , annual wormwood
Classification botanique : famille des astéracées ( Asteraceae )
Formes et préparations : poudres, gélules
Propriétés médicinales de l'absinthe chinoise
Utilisation interneParticipe au traitement du paludisme. Agit sur les troubles intestinaux (vers parasitaires et constipation ponctuelle). Réduit les symptômes des insolations et les maux de tête. Diminue notablement les saignements de nez.
Utilisation externe
Utilisées en cataplasmes, les feuilles d'absinthe chinoise sont indiquées contre la migraine et contre la fièvre.Indications thérapeutiques usuelles
L'absinthe chinoise est préconisée dans le traitement de la malaria (paludisme) et indiquée lors d'une insolation ou pour calmer la fièvre.Autres indications thérapeutiques démontrées
Cette plante est employée pour faire disparaître les vers parasitaires présents dans les intestins, en inhibant leur reproduction.Sources :
LAIS, Erika, Le Grand Livre des Plantes médicinales , Éditions Rustika ;
TROTIGNON, Elisabeth, Le Petit Livre des Plantes médicinales , Éditions du Chêneet hop une petite deuxieme.
Valériane

Noms communs : guérit-tout, herbe aux chats, herbe à la femme meurtrie, herbe à la menstrue et, plus récemment, valium végétal.
Nom botanique : Valeriana officinalis, famille des valérianacées.
Nom anglais : valerian.Parties utilisées : racine et rhizome.
Habitat et origine : originaire d'Europe et d'Asie du Nord, elle s'est rapidement naturalisée un peu partout, y compris en Amérique du Nord. Elle aime les sols humides et riches en minéraux.Indications
Traiter les troubles du sommeil, l'anxiété et l'agitation nerveuse.
Pour plus détails, voir la section Recherches sur la valériane.
Posologie de la valériane
Par voie interne
Troubles du sommeil
- Racine séchée : infuser de 2 g à 3 g, pendant 5 à 10 min, dans 150 ml d'eau bouillante. Prendre de 30 à 60 minutes avant de se coucher.
- Teinture (1:5) : prendre de 4 ml à 6 ml, 30 à 60 minutes avant de se coucher.
- Extrait normalisé (0,8 % d'acide valérinique ou valérique, 1-1,5 % de valtrates) : prendre de 400 mg à 600 mg, 30 à 60 minutes avant de se coucher.
Agitation nerveuse, anxiété
- Racine séchée : infuser de 2 g à 3 g, pendant 5 à 10 min, dans 150 ml d'eau bouillante. Prendre jusqu’à 5 fois par jour.
- Teinture (1:5) : prendre de 1 ml à 3 ml, jusqu’à 5 fois par jour.
- Extrait normalisé (0,8 % d'acide valérinique ou valérique, 1-1,5 % de valtrates) : prendre de 250 mg à 400 mg, 3 fois par jour.
Notes. Certaines sources mentionnent qu'il faut parfois prendre la plante pendant 2 à 4 semaines avant d'en ressentir pleinement les bienfaits, notamment en cas d'insomnie chronique.
Contrairement à ce qui se produit souvent avec les somnifères de synthèse, la prise de valériane au coucher et aux doses recommandées ne procure habituellement pas de sensation de « lendemain de veille » au lever21,22.
Par voie externe
- Bain calmant : Infuser 100 g de racines séchées dans 2 litres d'eau bouillante et ajouter à l'eau bien chaude de la baignoire.
Historique de la valériane
Les médecins de la Grèce antique, Hippocrate, Dioscoride et Galen, prescrivaient la valériane pour traiter l'insomnie. En grec ancien, le nom de la plante était « Phu », une allusion à l'odeur désagréable qui se dégage des racines séchées et des fleurs fanées. Les anciens Romains l'employaient pour combattre les palpitations et l'arythmie. Au Moyen Âge, la célèbre abbesse et herboriste allemande Hildegarde de Bingen recommandait la valériane comme tranquillisant et somnifère.
Dès la fin du XVIe siècle, les Européens ont commencé à l'employer pour soigner l'épilepsie. De leur côté, les Amérindiens calmaient les convulsions épileptiques en prisant de la poudre de racines de valériane et l'utilisaient également pour soigner les blessures. Durant la Première Guerre mondiale, les Européens ont pris de grandes quantités de valériane pour calmer la nervosité causée par les bombardements. De nos jours, la réputation de la valériane n’a pas faibli et elle est encore très utilisée. Aux États-Unis, par exemple, un sondage réalisé en 2002 par l’organisme Centers for Disease control and Prevention auprès de 31 000 personnes a révélé que 5,9 % des répondants avaient utilisé de la valériane et que 30 % d’entre eux l’avaient fait pour combattre l’insomnie1.
Recherches sur la valériane
 Troubles du sommeil. Jusqu’à présent, la recherche clinique n’a pas réussi à démontrer l’efficacité de la valériane pour traiter l’insomnie. Les résultats obtenus sont contradictoires et peu concluants dans l’ensemble. Dans le meilleur des cas, les personnes ayant pris des extraits de valériane ressentent une amélioration de leur sommeil2,4 et une diminution de la fatigue3. Toutefois, cette perception n’est validée par aucun critère objectif comme le temps d’endormissement, la durée du sommeil ou le nombre de réveils au cours de la nuit 2,5,7,8. Cela fait dire à certains chercheurs que la valériane ne serait pas plus efficace qu’un placebo6.
Troubles du sommeil. Jusqu’à présent, la recherche clinique n’a pas réussi à démontrer l’efficacité de la valériane pour traiter l’insomnie. Les résultats obtenus sont contradictoires et peu concluants dans l’ensemble. Dans le meilleur des cas, les personnes ayant pris des extraits de valériane ressentent une amélioration de leur sommeil2,4 et une diminution de la fatigue3. Toutefois, cette perception n’est validée par aucun critère objectif comme le temps d’endormissement, la durée du sommeil ou le nombre de réveils au cours de la nuit 2,5,7,8. Cela fait dire à certains chercheurs que la valériane ne serait pas plus efficace qu’un placebo6.
La seule chose sur laquelle les chercheurs s’entendent, c’est l’innocuité de la plante et la nécessité de mener des études mieux contrôlées2,9. En effet, la disparité des protocoles (dosage des extraits, durée du traitement) pourrait expliquer à elle-seule la variabilité des résultats obtenus. À cela s’ajoute l’hétérogénéité des extraits utilisés. Il faut savoir que la racine de valériane contient plus de 150 composés chimiques dont les proportions varient selon les conditions de culture et de récolte16 et selon les procédés de fabrication. Enfin, l’analyse des résultats est compliquée par la nature même de l’insomnie, un trouble du sommeil multifactoriel, difficile à évaluer et dans le traitement duquel l’effet placebo joue un rôle non négligeable.
La valériane est rarement utilisée seule. Traditionnellement, elle est souvent associée à d’autres plantes ayant des propriétés calmantes, telles que la mélisse ou le houblon. Quelques essais avec ce type de préparation ont donné des résultats positifs9-11.
Récemment, un essai clinique auprès d’une quarantaine de personnes a rapporté un effet bénéfique de la valériane (800 mg par jour pendant 8 semaines) chez des victimes du syndrome des jambes sans repos12. Les chercheurs ont observé une réduction des symptômes, une amélioration du sommeil et une diminution de la somnolence pendant la journée.
 Anxiété et agitation nerveuse. Des études menées sur les animaux suggèrent que la valériane pourrait agir sur certains messagers chimiques du cerveau de manière à réduire le stress et l’anxiété13. Quelques essais cliniques ont été menés auprès de personnes souffrant de stress19,20 ou de trouble anxieux généralisé18, mais les résultats sont insuffisants et ne permettent pas, pour l’instant, de valider ces effets sur l’humain14,15,17,25.
Anxiété et agitation nerveuse. Des études menées sur les animaux suggèrent que la valériane pourrait agir sur certains messagers chimiques du cerveau de manière à réduire le stress et l’anxiété13. Quelques essais cliniques ont été menés auprès de personnes souffrant de stress19,20 ou de trouble anxieux généralisé18, mais les résultats sont insuffisants et ne permettent pas, pour l’instant, de valider ces effets sur l’humain14,15,17,25.
 La Commission E, l’ESCOP et l'Organisation mondiale de la Santé reconnaissent l'usage de la valériane pour traiter l'agitation nerveuse et l'anxiété ainsi que les troubles du sommeil qui en découlent.
La Commission E, l’ESCOP et l'Organisation mondiale de la Santé reconnaissent l'usage de la valériane pour traiter l'agitation nerveuse et l'anxiété ainsi que les troubles du sommeil qui en découlent.
Précautions
Attention
- Éviter de conduire un véhicule ou de manipuler des outils dangereux dans les heures qui suivent la prise de valériane, en raison de son effet sédatif.
Contre-indications
- L’innocuité de la valériane n’est pas établie hors de tout doute chez les enfants, les femmes enceintes et celles qui allaitent.
Effets indésirables
- Presque inexistants aux doses recommandées, les quelques effets indésirables liés à la prise de valériane se limitent généralement à des malaises gastro-intestinaux légers et passagers.
- Prise à hautes doses, la valériane peut causer de la somnolence.
Interactions
Avec des plantes ou des suppléments
- Les effets de la valériane pourraient s'additionner à ceux d'autres plantes sédatives telles que le houblon, la camomille, la mélisse, la passiflore, etc.
Avec des médicaments
- Les effets de la valériane pourraient s'additionner à ceux des benzodiazépines, des barbituriques et de tous les hypnotiques, sédatifs et calmants.
- Des données cliniques sur des sujets en bonne santé indiquent que la valériane a peu d’effet sur les enzymes qui interviennent dans le métabolisme des médicaments23,24, ce qui implique une absence d’interaction.
-
Salut
je n'ai pas déformé tes propos, j'en avais juste extrait une partie .... mais je mets la phrase entiere si ça te conviens mieux
"si le canna n'est pas fumé, il ne présente aucun risque , ce qui n'est pas le cas de 95% des médicaments du commerce."
question : 95% des médicaments présentent donc des risques ....??? sur quelles bases statistiques ou scientifiques sérieuses tu te bases ??
Que des médicaments présentent des risques à l'utilisation c'est une évidence, les médicaments que je prends sont effectivement "à risques" mais, si je respire aujourd'hui et que je peux commenter les publications sur cannaweed c'est grâce à eux .... (et aussi au cannabis qui me permet de les prendre ....)
@+
-
Hey
bon .....
"l'auto-production me semble fondamentale dans le cadre d'une légalisation, même s'il ne s'agit que d'usage thérapeutique. "
l'auto production pour l'usage thérapeutique c'est comme mettre un chewing gum sur le pneu crevé d'un 38 tonnes et d’espérer que la roue va tenir 5000 bornes ....
ça n'est pas au malades de produire leurs médicaments, aucunes traçabilité, aucune stabilité ....
On parle de médicaments, pas de s'amuser, la composition d'un médicament ne change pas tous les 3 mois ...
"les gens sont capables de s'auto-médicamenter dans le cas de la majorité des traitements"
Ah bah la je crains que la compréhension de l'usage médical des cannabinoïdes vous échappe .... je connais enormement de malades qui sont juste incapables de ça, c'est pas parce que vous connaissez la plante que tous la connaisse et quoi qu'il en soit l'usage médical n'est pas à prendre à la légère ....
"si le canna n'est pas fumé, il ne présente aucun risque ...."
Outch .... faudra expliquer ça aux malades pour qui l'usage du cannabis à déclenché des pathologies psychiatriques latentes .....et aussi à ceux qui ne supportent pas les effets secondaires du cannabis ....
"Moi je me demandais si en Allemagne ils développaient vraiment des médicaments a base de cannabis ou si les avait juste accès a des fleurs séchées ( de qualité médicale genre bedrocan entre autres ) en pharmacie"
En Allemagne le Sativex est en pharmacie et les fleurs de chanvre sont vendu au rayon "complément alimentaire" (pour ce qui concerne les thé ....) et ne sont pas considérés comme des "médicaments" ... les specialités de Bedrocan ne sont pas encore accessibles dans tous les lands, loin de la, et ne sont de toute façon pas considérées comme des médicaments (d'ailleurs Francky le dis trés bien dans son message au dessus : "Un médicament, dans le sens moderne du terme, répond à des exigences précises (dosage, composition, utilisation, ...)." on pourrait ajouter traçabilité stabilité .... et surtout il est nécessaire qu'un cadre médical soit la base de l'usage thérapeutique .... (au minimum un médecin, un pharmacien pour accompagner et aider le patient)
Leur système se met en place et un des toubib les plus actifs en Allemagne a déjà fait plusieurs gréve de la faim pour dénoncer les manques et imperfections de ce merdier (les mutuelles qui refusent de rembourser par exemple) ....
je suis malade et je produis, mais je rêve du jour ou je n'aurais plus à le faire, au moins pour le médical ....
demander aux malades ou les laisser devant le fait de se démerder seuls est la pire des solution et les "obliger", soit à cultiver, soit à rester avec leurs souffrances ne règle rien au probleme ....
On n'implique pas les malades dans leurs traitements en les faisant cultiver ou en ne leur laissant que cette possibilité (en dehors du marché noir) bien au contraire ...
bonne journée
@+
-
 2
2
-
-
Hey
1er bulletin de Fevrier ....
http://www.cannabis-med.org/french/bulletin/ww_fr_db_cannabis_artikel.php?id=453
enjoy
@+

IACM-Bulletin du 11 Février 2018
- Science/Homme: La consommation de cannabis n’est pas associée à des effets négatifs sur la respiration
- Science/Homme: L’exercice augmente les niveaux d’endocannabinoïdes dans le sang
- En bref
- Un coup d'œil sur le passé
Science/Homme: La consommation de cannabis n’est pas associée à des effets négatifs sur la respiration
La consommation de cannabis n’est pas associée à des risques accrus de maladies respiratoires. C’est la conclusion d’une analyse sur 2 304 participants, dont 49% qui n’ont jamais consommé de cannabis, 43% d’anciens utilisateurs et 8% de consommateurs de cannabis. Ce sont les résultats des chercheurs de l’École de Santé publique du Colorado, aux États-Unis, qui ont été publiés dans la revue Chronic Obstructive Pulmonary Diseases.
L’enquête a révélé que l’usage actuel ou antérieur du cannabis n’était pas associé à une augmentation des risques de respiration sifflante, de toux ou de bronchite chronique par rapport aux non-usagers. Les utilisateurs de cannabis actuels et anciens avaient moins d’emphysèmes et un meilleur volume expiratoire maximal en une seconde (VEMS1%). Cependant, l’usage intensif de cannabis a été associé à d’autres symptômes de la bronchite chronique.
Science/Homme: L’exercice augmente les niveaux d’endocannabinoïdes dans le sang
L’exercice aérobique (courir sur un tapis roulant par exemple dans ce cas) augmente l’humeur et les niveaux sanguins des endocannabinoïdes. Ceci est le résultat d’une étude menée par des chercheurs de l’Université du Wisconsin à Madison et de l’École de Médecine du Wisconsin à Milwaukee, États-Unis, auprès de 12 adultes diagnostiqués de trouble de stress post-traumatique (TSPT) et auprès de 12 autres personnes considérées en bonne santé. Les participants ont couru sur un tapis roulant pendant 30 minutes à intensité modérée.
Les concentrations circulantes des endocannabinoïdes anandamide (AEA, arachidonoylethanolamide) et 2-AG (2-arachidonoylglycérol) ont augmenté de façon significative. Cet effet était plus fort chez les adultes en bonne santé que chez les patients atteints de TSPT. Les auteurs ont conclu que «le système endocannabinoïde était activé chez les adultes avec et sans TSPT, bien que l’envergure de l’effet suggère que les adultes atteints de TSPT peuvent avoir une réponse d’endocannabinoïdes moindre à l’exercice».
En bref
Etats-Unis: Le Vermont légalise le cannabis à des fins récréatives
Le Vermont est officiellement le neuvième État des États-Unis à légaliser le cannabis et le premier à mettre fin à la prohibition du cannabis par le biais d’un acte législatif. Les changements législatifs précédents, qui ont mis fin à l’interdiction du cannabis dans huit États, étaient basés sur des initiatives de vote. En vertu de la nouvelle loi, les personnes âgées de plus de 21 ans seront autorisées à détenir légalement jusqu’à une once (environ 28 g) de cannabis et à cultiver jusqu’à deux plants de cannabis matures et quatre en croissance.
Forbes du 22 Janvier 2018France: Un rapport demandé par le gouvernement suggère la décriminalisation de toutes les drogues
Deux membres de l’Assemblée ont été chargés par le gouvernement, par l’intermédiaire de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale, d’étudier les politiques de la France en matière de drogues et de recommander des changements susceptibles d’alléger le système de justice pénale du pays. Fait inhabituel, malgré la rédaction du rapport, les deux parlementaires ont divergé sur leurs recommandations de réforme législative; ils ont donc décidé de laisser le gouvernement choisir entre deux options pour répondre aux problèmes de possession personnelle de drogues.
Talking Drugs du 22 Janvier 2018Science/Homme: Il n’y a pas suffisamment de preuves des effets de l’usage du cannabis sur le risque d’AVC ni sur celui de crise cardiaque
Les auteurs d’une revue des études examinant les effets de l’usage du cannabis sur le cœur et la circulation ont conclu que «les preuves examinant l’effet de la marijuana sur les facteurs de risque cardiovasculaire et les résultats y compris l’accident vasculaire cérébral et l’infarctus du myocarde sont insuffisantes».
Le Centre d’Études médicales supérieures de Wright, Scranton, États-Unis.
Ravi D, et al. Ann Intern Med. 23 Jan 2018. [in press]Science/Homme: L’utilisation de cannabis n’a aucun effet significatif sur la fertilité
Dans une étude sur 4 194 femmes (1 125 en couples), le cannabis utilisé par les hommes et par les femmes n’a pas eu d’effet significatif sur la fertilité.
École de Santé publique de l’Université de Boston, États-Unis.
Wise LA, et al. J Epidemiol Community Health. 2 Déc 2017. [in press]Science/Homme: La consommation de cannabis réduit la consommation de cannabis
L’administration d’un l’extrait de cannabis Sativex et la thérapie comportementale ont réduit la consommation de cannabis chez 40 personnes dépendantes au cannabis. Les participants ont reçu jusqu’à environ 110 mg de THC dans l’extrait ou un placebo pendant 12 semaines.
Centre de Toxicomanie et de Santé mentale, Toronto, Canada.
Trigo JM, et al. PLoS One. 2018;13(1):e0190768.Science/Animal: L’activation du récepteur CB1 a augmenté les effets antidépresseurs du magnésium et du zinc
Lors d’une étude sur des souris, de faibles doses d’oléamide ont augmenté les effets antidépresseurs du magnésium et du zinc. Les auteurs ont écrit qu’elles produisaient des effets «au moins additifs».
Université médicale de Lublin, Pologne.
Wośko S, et al. J Pharm Pharmacol. 30 Jan 2018. [in press]Science/Animal: La dilatation des vaisseaux sanguins induite par les cannabinoïdes ne dépend pas seulement de l’activation des récepteurs au cannabis
La recherche révèle que la dilatation des vaisseaux sanguins par les cannabinoïdes ne dépend pas seulement de l’activation des récepteurs CB1 et CB2 sur l’endothélium ou sur la paroi interne des vaisseaux sanguins, mais qu’elle implique également d’autres mécanismes.
Institut de Physiologie de Bogomoletz NAS d’Ukraine, Kiev, Ukraine.
Bondarenko AI, et al. Vascul Pharmacol. 17 Jan 2018. [in press]Science/Homme: La restriction calorique, chez les patients atteints de diabète de type 2, réduit les taux d’endocannabinoïdes
Lors d’une étude sur 27 patients souffrant d’obésité et atteints à la fois de diabète de type 2 et de maladies coronariennes, les chercheurs ont découvert qu’après une restriction calorique à 1000 kcal par jour pendant 16 semaines les taux sanguins d’endocannabinoïdes y compris celui de l’anandamide, mais pas du 2-AG, avaient diminué.
Centre Médical Universitaire de Leiden, Pays-Bas.
van Eyk HJ, et al. Nutr Diabetes. 2018;8(1):6.Un coup d'œil sur le passé
Il y a un an
Il y a deux ans
-
 1
1
-
Hey
pour completer la reponse de Maglooz :
https://www.marybiles.com/blog/can-cannabis-cure-cancer-we-just-dont-know-yet-says-manuel-guzman
et le professeur Meiri :
@+
-
RE Hey

La Salvia
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/salvia/fr
@+
Salvia divinorum
La plante psychotrope Salvia divinorum, ou «Sauge des devins», est un membre rare de la famille des menthes (Lamiaceae; anciennement Labiatae), qui a été caractérisée au milieu du vingtième siècle. La plante est endémique d’une petite région montagneuse de l’État d’Oaxaca (Mexique), où les Indiens mazatèques ingèrent ses feuilles fraîches ou des préparations à base de feuilles lors de rituels divinatoires, de rites de guérison ou à des fins médicales. Depuis la fin des années 1990, l'utilisation de la plante comme hallucinogène végétal «légal» a augmenté, en partie du fait de sa disponibilité. Fumer les feuilles séchées et broyées fournit des hallucinations de courte durée mais intenses. La dose efficace de salvinorine A, le principe actif de la plante, est comparable à celle des hallucinogènes synthétiques LSD ou DOB. La toxicité de Salvia divinorum n'est pas suffisamment connue.
Chimie
L'identification chimique du principe psychoactif de Salvia divinorum a été faite simultanément par Ortega et Valdés au début des années 1980. Le principal composant responsable de l'effet psychoactif de la plante est un diterpène de la famille des néoclérodanes appelé salvinorine A. La dénomination systématique selon l'UICPA est ester méthylique de l'acide (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acétyloxy)-2-(3-furanyl)dodécahydro-6a,10b-diméthyl-4,10-dioxo-2H-naphto[2,1-c]pyran-7-carboxylique (numéro CAS: 83729-01-5). Contrairement aux hallucinogènes classiques naturels ou synthétiques, la salvinorine A ne contient pas d'atome d'azote — ce n'est pas un alcaloïde.
Les feuilles séchées, les extraits de feuille et la salvinorine A pure sont stables à température ambiante en l'absence de lumière ou d'air, bien qu'il n'existe pas d'étude systématique à ce sujet. La salvinorine A est instable dans les solutions basiques et est soluble dans les solvants organiques conventionnels, à savoir l'acétone, l'acétonitrile, le chloroforme, le diméthylsulfoxyde et le méthanol, mais elle est essentiellement insoluble dans l'hexane et l'eau.Structure moléculaire de la salvinorine A
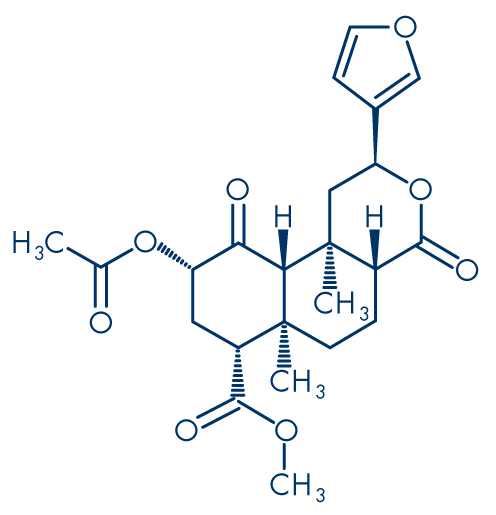
Formule moléculaire: C23H28O8
Poids moléculaire: 432.47 g/molForme physique
Salvia divinorum est une herbe arbustive vivace qui peut atteindre 0,5 à 1,5 mètre. Elle peut être aisément identifiée par ses tiges rectangulaires et creuses et des paires opposées de feuilles ovales ou lanciformes, dentelées, qui sont généralement veloutées ou velues. La fleur caractéristique de la plante a une corolle blanche ornée d'un calice bleu-violet. Salvia divinorum produit rarement des graines, et les rares graines produites ne sont pas souvent viables. La propagation de la plante est ainsi exclusivement végétative et la plupart des plantes Salvia divinorum actuellement cultivées dans le monde entier sont des clones d’un petit nombre de collections d’Oaxaca précédemment accumulées.
Les feuilles séchées et broyées enrichies avec des extraits d'autres feuilles sont vert foncé, brunâtre ou même vert tirant sur le noir, du fait de la présence de pigments concentrés.
La salvinorine A pure forme des cristaux incolores ayant un point de fusion de 242-244 °C.Pharmacologie
La salvinorine A présente un mode d'action et une pharmacologie uniques. Elle exerce une activité d'agoniste complet puissante et sélective au niveau des sous-types de récepteurs opioïdes kappa (KOR). Celle-ci est essentiellement responsable de l'effet hallucinogène de la drogue. Les hallucinogènes «classiques» tels que la psilocybine, le LSD ou le DOB, qui sont tous de nature alcaloïde, quant à eux, interagissent avec les sous-types de récepteurs de la sérotonine. Aucune liaison notable n'est observée entre la salvinorine A et plus de 50 autres récepteurs importants sur le plan (psycho)pharmacologique, protéines transporteurs et canaux ioniques.
Chez les humains, la salvinorine A induit des hallucinations profondes de courte durée. L'inhalation de doses équivalentes à 200 à 500 microgrammes de salvinorine A conduit à une perte de contrôle des mouvements physiques (incapacité); un fou rire; des hallucinations vives, colorées et souvent bizarres, s'apparentant à un rêve ou à un film. Les frontières temporelles entre passé, présent et futur disparaissent et l'utilisateur est transporté dans une dimension temporelle et spatiale alternative (dislocation spatio-temporelle) avec l'impression d'être en plusieurs endroits en même temps. Le «trip», en particulier à des doses plus élevées, peut être effrayant et peut causer des troubles psychotiques graves. Il a été signalé que cela peut durer plusieurs heures après que les hallucinations aient disparu. Les effets secondaires courants comprennent une fatigue, des vertiges et une amnésie. Des rapports des services d'urgences ont décrit une psychose persistante chez des individus vulnérables.
Des études expérimentales préliminaires menées par Mowry et al. (2003) ont montré que la salvinorine A présentait une toxicité relativement faible pour les rongeurs. Cependant, aucune autre étude n'a examiné l'effet physiologique toxique aigu ou chronique des feuilles ou des divers extraits de Salvia divinorum.
Origine
Du fait que les graines de Salvia divinorum sont difficiles à obtenir, la plante est propagée par bouturage. Les jeunes plants ainsi que les feuilles séchées sont faciles à obtenir sur l’Internet ou dans des boutiques spécialisées dans les pays où il n'existe pas de restrictions réglementaires. La culture domestique des plantes est possible et des instructions décrivant les conditions de culture optimales, l'utilisation d'engrais et de pesticides chimiques sont disponibles sur l’Internet dans plusieurs langues.
On trouve la salvinorine A dans la résine secrétée par des cellules épidermiques velues spéciales (trichomes), qui sont particulièrement abondantes sur les feuilles. Des préparations constituées d'une feuille enrichie par des extraits de 4 à 49 autres feuilles (les produits respectifs sont ainsi appelés extraits 5X à 50X) sont également disponibles en ligne et dans des boutiques spécialisées. Cependant, la concentration réelle en salvinorine A dans les produits de Salvia divinorum est généralement inconnue. La salvinorine A sous forme pure et cristalline ne semble pas être offerte sur le marché (ni en ligne ni dans les smartshops) mais des procédures illustrées d'isolation sont disponibles sur l’Internet.
Des synthèses chimiques totales de salvinorine A ont été récemment réalisées mais elles sont trop complexes pour être utilisées pour la production de la substance.
À ce jour, la salvinorine A n'a été décelée dans aucune autre espèce de Salvia analysée.
Mode de consommation
Traditionnellement, les Indiens mazatèques roulent les feuilles fraîches de la plante en une chique ayant la forme d'un cigare, qui est ensuite sucée ou mâchée sans en avaler le jus pour augmenter l'absorption du composant actif.
Le feuillage frais peut également être broyé manuellement ou à l'aide d'une pierre à moudre et peut être utilisé pour préparer une infusion. Au moins six feuilles sont nécessaires pour obtenir un effet perceptible, qui se manifeste après environ 10 minutes et dure 45 minutes ou plus.
Pour un usage récréatif, le mode d'administration le plus courant est de fumer les feuilles séchées broyées à la pipe ou en utilisant une pipe à eau/bang, provoquant en une minute des hallucinations de courte durée (15 à 20 minutes). En général, une quantité de 0,25 à 0,75 gramme de feuille est fumée.
Un effet plus durable est obtenu en mâchant les feuilles amères sous forme d'une chique et les doses typiques pour produire des effets légers à modérés sont de 10 à 30 grammes de feuilles fraîches ou 2 à 5 grammes de feuilles séchées.
Une application sublinguale de teintures à base d'éthanol aqueux préparées à partir de feuilles conduit à un effet qui débute après 5 à 10 minutes et qui peut durer jusqu'à 2 heures.
Une infusion obtenue en faisant tremper des feuilles dans de l'eau chaude est relativement inefficace car la salvinorine A se dégrade facilement dans l’appareil gastro-intestinal. La vaporisation de feuilles séchées ou d'extraits sans les brûler nécessite un appareillage spécial et des températures assez élevées (> 200° C) et n'est pas une méthode d'utilisation habituelle.
L’inhalation de vapeurs de salvinorine A pure comporte des risques importants pour la santé car la quantité inhalée ne peut pas être maîtrisée. Cette dernière méthode peut conduire à une «surdose», qui se manifeste sous la forme de troubles psychotiques.
Autres dénominations
Au Mexique, la plante est nommée en espagnol «hojas de la pastora» ou «ska María pastora». Les noms couramment employés dans la langue anglaise sont: Diviner’s Sage, Lady Salvia, Magic Mint, Purple Sticky, Sally D, Sage of the Seers ou simplement et le plus souvent Salvia. D'autres noms dans d'autres langues européennes sont: en français — sauge des devins, sauge divinatoire; en allemand — Wahrsagersalbei.
Analyse
La teneur en salvinorine A d'échantillons botaniques peut être analysée par chromatographie sur couche mince ou par chromatographie liquide haute performance avec détection d’UV. La détection et la quantification de la salvinorine A dans le sang, l'urine et la salive de l'ordre du nanogramme/ml nécessite des méthodes plus sensibles telles que la chromatographie gazeuse ou la chromatographie liquide haute performance couplées à un spectromètre de masse. Le spectre de masse obtenu par ionisation électronique de la salvinorine A présente des fragments significatifs à m/z 94, 55, 121, 107, 273, 166, 220, 252, 234, 359, 318, 404 et 432 (par ordre décroissant d'abondance).
Le spectre UV d'une solution méthanolique de salvinorine A présente un maximum à 211 nm. Les bandes d'absorption caractéristiques du spectre infrarouge de la salvinorine A dispersée dans une pastille de KBr sont observées à 3 220, 1 745, 1 735, 1 240, et 875 cm-1.
Lorsque l'identification de la matière végétale sous forme de poudre est impossible, des méthodes d'empreinte ADN peuvent être utilisées.La salvinorine A et les autres diterpénoïdes de la plante ne sont pas détectés par les méthodes conventionnelles de dépistage de drogues.
Pureté typique
La composition chimique des feuilles de Salvia divinorum dépend du stade de développement de la plante et/ou du type de préparation. Des études systématiques de plantes de différentes collections montrent que la concentration en salvinorine A dans les plantes adultes est comprise entre 0,89 et 3,7 mg/g de feuilles séchées (correspondant à une moyenne de 0,245 %).
Les résultats d'analyses récentes de Salvia divinorum, sur cinq échantillons obtenus sur l’Internet ou dans des «head shops» aux États-Unis ont révélé de grandes différences dans les concentrations en salvinorine A. Dans les feuilles séchées (enrichissement nominal 1X, «X» faisant référence au nombre de fois la puissance de l'extrait par rapport à la feuille) la concentration du composant psychoactif était de 0,408 mg/g, alors que pour les extraits enrichis 5X (deux échantillons), 10X et 20X, les concentrations en salvinorine A étaient, respectivement, de 0,126/1,137, 0,951 et 0,461 mg/g, ce qui laisse supposer que l'étiquetage ne correspondait pas à la teneur réelle.
L'étude des échantillons a également révélé que certains contenaient de la vitamine E et de la caféine en tant qu’adultérants.
Une analyse récente d'échantillons vendus au Japon a révélé des concentrations en salvinorine A comprises entre 3,2 et 5,0 mg/g pour des feuilles séchées, et entre 4,1 et 38,9 mg/g pour des préparations enrichies 2X à 25X.
Contrôle
Salvia divinorum et la salvinorine A ne figurent dans aucune des listes des Conventions des Nations unies sur les drogues.
Cependant, ces dernières années Salvia divinorum et son principe actif, la salvinorine A ont commencé à faire l’objet d’une surveillance dans le cadre de la législation sur les drogues en Belgique, au Danemark, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, en Roumanie et en Suède, en Australie et au Japon ainsi que dans plusieurs états des États-Unis.
Seuls la Croatie, l’Allemagne, la Pologne et l’Espagne ont placé cette plante sous contrôle. En Estonie, Finlande et Norvège, Salvia divinorum relève de la législation sur les médicaments. Enfin, la vente de Salvia sans autorisation est illégale au Canada, conformément au règlement sur les produits de santé naturels.Prévalence
Dans les pays européens, les informations sur l’étendue de l’usage de Salvia divinorum et de ses préparations sont limitées.
En Roumanie, une enquête de 2008 auprès de jeunes gens vivant à Budapest âgés de 15 à 34 ans qui fréquentent des lieux récréatifs, a montré que 0,3 % d’entre aux avaient essayé Salvia divinorum au moins une fois dans leur vie.
Dans une enquête en ligne effectuée fin 2009 auprès de personnes fréquentant des discothèques au Royaume-Uni, 3,2 % des répondants admettent qu'ils ont consommé Salvia divinorum dans le mois précédent, ce qui la classe au quinzième rang des drogues les plus couramment utilisées à cette fréquence. La prévalence au cours de la vie atteint 29,2 %. Ces observations ne peuvent cependant pas être considérées comme étant représentatives de l'ensemble de la population des personnes fréquentant les discothèques, du fait des limitations méthodologiques des enquêtes en ligne.
Aux États-Unis, l'enquête nationale annuelle sur l'usage de drogues et la santé (National Survey on Drug Use and Health) réalisée en 2006 indique que la consommation sur les 12 derniers mois de Salvia divinorum était de 0,3 % chez les personnes âgées de 12 ans ou plus; au total environ 1,8 million de personnes admettent avoir déjà consommé cette drogue.
D’après le récent rapport intitulé «Monitoring the Future» de l'Institut national sur l'abus de drogues (National Institute on Drug Abuse), en 2009, la prévalence de Salvia divinorum au cours de l'année écoulée était de 6,0 % parmi les étudiants du niveau secondaire supérieur (ce pourcentage est plus élevé que la prévalence de l'ecstasy au cours de l'année précédente). Il s'avère que la consommation de Salvia divinorum est plutôt limitée et expérimentale; il ne s’agit pas d’une drogue sociale ou festive.
Il ressort d’une étude menée en 2006 par Khey et al. auprès d’étudiants dans un lycée américain (moyenne d'âge de 19,8 ans) que les prévalences au cours de la vie, au cours de l'année précédente et au cours du mois précédent, étaient respectivement de 6,7, 3,0 et 0,5 %, la moitié des étudiants interrogés n'exprimant pas le désir de consommer à nouveau. Ceci laisse supposer que la consommation de Salvia divinorum peut présenter un faible taux de continuation.
Prix au détail
Les prix varient entre les pays et dépendent du type et de la quantité de produit concerné. Une «photo instantanée» des boutiques en ligne réalisée début 2011 par l'OEDT a montré que les prix sur le marché européen pour un seul jeune plant de Salvia divinorum oscillaient entre 7 et 40 EUR. Les feuilles séchées coûtent entre 0,27 EUR (paquet de 1 kilogrammes) et 1,5 EUR le gramme (paquet de 1 gramme).
La «photo instantanée» réalisée par l'OEDT a également montré que le prix des extraits «Salvia 5X» vendus en quantité aussi petite qu’un demi gramme est 11–12 EUR. L’extrait «Salvia 40X» coûte autour d'EUR 30 pour demi gramme.
Usage médical
Aucun usage médical de Salvia divinorum ou de la salvinorine A n'est approuvé. Cependant, des recherches intensives sont menées pour explorer le potentiel thérapeutique d'agonistes ou d'antagonistes des KOR apparentés.
Bibliography
Albertson, D. N., et Grubbs, L. E. (2009), ‘Subjective effects of Salvia divinorum: LSD- or marijuana-like?’, Journal of Psychoactive Drugs, Volume 41, pp. 213–217.
Appel, J., et Kim-Appel, D. (2007), ‘The rise of a new psychoactive agent: Salvia divinorum’, International Journal of Mental Health and Addiction, Volume 5, pp. 248–253.
Baggott, M. J., Erowid, E. Erowid, F., et Mendelson, J. E. (2004), ‘Use of Salvia divinorum, an unscheduled hallucinogenic plant: a web-based survey of 500 users’, Clinical Pharmacology and Therapeutics, Volume 75, p. 72.
Bertea, C. M., Luciano, P., Bossi, S. et al. (2006), ‘PCR and PCR–RFLP of the 5S-rRNA-NTS region and salvinorin A analyses for the rapid and unequivocal determination of Salvia divinorum’, Phytochemistry, Volume 67, pp. 371–378.
Beerepoot, P., Lam, V., Luu, A., Tsoi, B., Siebert, D., et Szechtman, H. (2008), ‘Effects of salvinorin A on locomotor sensitization to D2/D3 dopamine agonist quinpirole’, Neuroscience Letters, Volume 446, pp. 101–104.
Biglete, S. A., Lai, E. P., Lee, D. Y., Nyi, P. P., Torrecer, G. I., et Anderson, I. B. (2009), ‘Influence of age on Salvia divinorum abuse: results of an Internet survey’, Clinical Toxicology, Volume 47, p. 712.
Braida, D., Capurro, V., Zani, A. et al. (2009), ‘Potential anxiolytic- and antidepressant-like effects of salvinorin A, the main active ingredient of Salvia divinorum, in rodents’, British Journal of Pharmacology, Volume 157, pp. 844–853.
Braida, D., Limonta, V., Capurro, V. et al. (2008), ‘Involvement of κ-opioid and endocannabinoid system on salvinorin A-induced reward’, Biological Psychiatry, Volume 63, pp. 286–292.
Capasso, R., Borrelli, F., Cascio, M. G., Aviello, G., Huben, K. et al. (2008), ‘Inhibitory effect of salvinorin A, from Salvia divinorum, on ileitis-induced hypermotility: cross-talk between κ-opioid and cannabinoid CB1 receptors’, British Journal of Pharmacology, Volume 155, pp. 681–689.
Carlezon, W. A., Jr., Béguin, C., Knoll, A. T., et Cohen, B. M. (2009), ‘Kappa-opioid ligands in the study and treatment of mood disorders’, Pharmacology and Therapeutics, Volume 123, pp. 334–342.
Chavkin, C., Sud, S., Jin, W. et al. (2004), ‘Salvinorin A, an active component of the hallucinogenic sage Salvia divinorum is a highly efficacious κ-opioid receptor agonist: structural and functional considerations’, The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, Volume 308, pp. 1197–1203.
Epling, C., et Játiva-M, C. D. (1962), ‘A new species of Salvia from Mexico’, Botanical Museum Leaflets, Harvard University, Volume 20, pp. 75–76.
Giroud, C., Felber, F., Augsburger, M., Horisberger, B., Rivier, L., et Mangin, P. (2000), ‘Salvia divinorum: an hallucinogenic mint which might become a new recreational drug in Switzerland’, Forensic Science International, Volume 112, pp. 143–150.
González, D., Riba, J., Bouso, J. C., Gómez-Jarabo, G., et Barbanoj, M. J. (2006), ‘Pattern of use and subjective effects of Salvia divinorum among recreational users’, Drug and Alcohol Dependence, Volume 85, pp. 157–162.
Gruber, J. W., Siebert, D. J., Der Marderosian, A. H., et Hock, R. S. (1999), ‘High performance liquid chromatographic quantification of salvinorin A from tissues of Salvia divinorum Epling & Játiva-M.’, Phytochemical Analysis, Volume 10, pp. 22–25.
Grundmann, O., Phipps, S. M., Zadezensky, I., et Butterweck, V. (2007), ‘Salvia divinorum and salvinorin A: An update on pharmacology and analytical methodology’, Planta Medica, Volume 73, pp. 1039–1046.
Hanes, K. R. (2001), ‘Antidepressant effects of the herb Salvia divinorum: a case report’, Journal of Clinical Psychopharmacology, Volume 21, pp. 634–635.
Harding, W. W., Tidgewell, K., Byrd, N. et al. (2005), ‘Neoclerodane diterpenes as a novel scaffold for μ opioid receptor ligands’, Journal of Medicinal Chemistry, Volume 48, pp. 4765–4771.
Hofmann, A. (1979), LSD — Mein Sorgenkind. Die Entdeckung einer ‘Wunderdroge’, J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Stuttgart, ISBN: 3-12-923601-5 (première édition).
Hooker, J. M., Xu, Y., Schiffer, W., Shea, C., Carter, P., et Fowler, J. S. (2008), ‘Pharmacokinetics of the potent hallucinogen, salvinorin A in primates parallels the rapid onset and short duration of effects in humans’, NeuroImage, Volume 41, pp. 1044–1050.
Imanshahidi, M., et Hosseinzadeh, H. (2006), ‘The pharmacological effects of Salvia species on the central nervous system’, Phytotherapy Research, Volume 20, pp. 427–437.
Jermain, J. D., et Evans, H. K. (2009), ‘Analyzing Salvia divinorum and its active ingredient salvinorin A utilizing thin layer chromatography and gas chromatography/mass spectrometry’, Journal of Forensic Sciences, Volume 54, pp. 612–616.
Khey, D. N., Miller, B. L., et Griffin, O. H. (2008), ‘Salvia divinorum use among a college student sample’, Journal of Drug Education, Volume 38, pp. 297–306.
Lange, J. E., Daniel, J., Homer, K., Reed, M. B., et Clapp, J. D. (2010), ‘Salvia divinorum: Effects and use among YouTube users‘ Drug and Alcohol Dependence 108, pp. 138–140.
Li, Y., Husbands, S. M., Mahon, M. F., Traynor, J. R., et Rowan, M. G. (2007), ‘Isolation and chemical modification of clerodane diterpenoids from Salvia species as potential agonists at the κ-opioid receptor’, Chemistry and Biodiversity, Volume 4, pp. 1586–1593.
McDonough, P. C., Holler, J. M., Vorce, S. P., Bosy, T. Z., Magluilo, J., Jr., et Past, M. R. (2008), ‘The detection and quantitative analysis of the psychoactive component of Salvia divinorum, salvinorin A, in human biological fluids using liquid chromatography–mass spectrometry’, Journal of Analytical Toxicology, Volume 32, pp. 417–421.
Medana, C., Massolino, C., Pazzi, M., et Baiocchi, C. (2006), ‘Determination of salvinorins and divinatorins in Salvia divinorum leaves by liquid chromatography/multistage mass spectrometry’, Rapid Communications in Mass Spectrometry, Volume 20, pp. 131–136.
Mowry, M., Mosher, M., et Briner, W. (2003), ‘Acute physiologic and chronic histologic changes in rats and mice exposed to the unique hallucinogen salvinorin A’, Journal of Psychoactive Drugs, Volume 35, pp. 379–382.
National Institute on Drug Abuse (2009), ‘NIDA InfoFacts: Salvia’.
Nozawa, M., Suka, Y., Hoshi, T., Suzuki, T., et Hagiwara, H. (2008), ‘Total synthesis of the hallucinogenic neoclerodane diterpenoid salvinorin A’, Organic Letters, Volume 10, pp. 1365–1368.
Ortega, A., Blount, J. F., et Manchand, P. S. (1982), ‘Salvinorin, a new trans-neoclerodane diterpene from Salvia divinorum (Labiatae)’, Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1, pp. 2505–2508.
Paulzen, M., et Gründer, G. (2008), ‘Toxic psychosis after intake of the hallucinogen salvinorin A’, Journal of Clinical Psychiatry, Volume 69, pp. 1501–1502.
Pfeiffer, A., Brantl, V., Herz, A., et Emrich, H. M. (1986), ‘Psychotomimesis mediated by κ opiate receptors’, Science, Volume 233, pp. 774–776.
Pichini, S., Abanades, S., Farré, M. et al (2005), ‘Quantification of the plant-derived hallucinogen Salvinorin A in conventional and non-conventional biological fluids by gas chromatography/mass spectrometry after Salvia divinorum smoking’, Rapid Communications in Mass Spectrometry, Volume 19, pp. 1649–1656.
Prisinzano, T. E. (2009), ‘Natural products as tools for neuroscience: discovery and development of novel agents to treat drug abuse’, Journal of Natural Products, Volume 72, pp. 581–587.
Przekop, P., et Lee, T. (2009), ‘Persistent psychosis associated with Salvia divinorum use’, American Journal of Psychiatry, Volume 166, p. 832.
Roth, B. L., Baner, K., Westkaemper, R. et al. (2002), ‘Salvinorin A: A potent naturally occurring nonnitrogenous κ opioid selective agonist’, Proceedings of the National Academy of Sciences, US, Volume 99, pp. 11934–11939.
Scheerer, J. R., Lawrence, J. F., Wang, G. C., et Evans, D. A. (2007), ‘Asymmetric synthesis of salvinorin A, a potent κ-opioid receptor agonist’, Journal of the American Chemical Society, Volume 129, pp. 8968–8969.
Schmidt, M. D., Schmidt, M. S., Butelman, E. R. et al. (2005), ‘Pharmacokinetics of the plant-derived κ-opioid hallucinogen Salvinorin A in nonhuman primates’, Synapse, Volume 58, pp. 208–210.
Seeman, P., Guan, H.-C., et Hirbec, H. (2009), ‘Dopamine D2High receptors stimulated by phencyclidines, lysergic acid diethylamide, salvinorin A, and modafinil’, Synapse, Volume 63, pp. 698–704.
Siebert, D. (2004), ‘Localization of salvinorin A and related compounds in glandular trichomes of the psychoactive sage, Salvia divinorum’, Annals of Botany, Volume 93, pp. 763–771.
Siebert, D. J. (1994), 'Salvia divinorum and Salvinorin A: new pharmacological findings', Journal of Ethnnopharmacology, Volume 43,pp. 53–56.
Siemann, H., Specka, M., Schifano, F., Deluca, P., et Scherbaum, N. (2006), ‘Salvia divinorum – Präsenz einer neuen Droge im Internet’, Gesundheitswesen, Volume 68, pp. 323–327.
‘Teen marijuana use tilts up, while some drugs decline in use’, 14 décembre 2009.
Tsujikawa, K., Kuwayama, K., Miyaguchi, H., Kanamori, T., Iwata, Y. T., et Inoue, H. (2009), ‘In vitro stability and metabolism of salvinorin A in rat plasma’, Xenobiotica, Volume 39, pp. 391–398.
Valdés, L. J., III, Butler, W. M., Hatfield, G. M., Paul, A. G., et Koreeda, M. (1984), ‘Divinorin A, a psychotropic terpenoid, and divinorin B from the hallucinogenic Mexican mint Salvia divinorum’, Journal of Organic Chemistry, Volume 49, pp. 4716–4720.
Valdés, L. J., III, Hatfield, G. M., Koreeda, M., et Paul, A. G. (1987), ‘Studies of Salvia divinorum (Lamiaceae), an hallucinogenic mint from the Sierra Mazateca in Oaxaca, Central Mexico’, Economic Botany, Volume 41, pp. 283–291.
Vohra, R., Seefeld, A., Cantrell, F. L., et Clark, R. F. (2009), ‘Salvia divinorum: exposures reported to a statewide poison control system over 10 years’, The Journal of Emergency Medicine.
Vortherms, T. A., et Roth, B. L. (2006), ‘Salvinorin A. From natural product to human therapeutics’, Molecular Interventions, Volume 6, pp. 259–267.
Wolowich, W. R., Perkins, A. M., et Cienki, J. J. (2006), ‘Analysis of the psychoactive terpenoid salvinorin A content in five Salvia divinorum herbal products’, Pharmacotherapy, Volume 26, pp. 1268–1272.
Zhang, Y., Butelman, E. R., Schlussman, S. D., Ho, A., et Kreek, M. J. (2005), ‘Effects of the plant-derived hallucinogen salvinorin A on basal dopamine levels in the caudate putamen and in a conditioned place aversion assay in mice: agonist actions at kappa opioid receptors’, Psychopharmacology, Volume 179, pp. 551–558.
-
 1
1
-
-
Hey
aujourd'hui Datura
bonne lecture
@+
Le datura
Le datura stramonium ou datura stramoine ou ‘’pomme épineuse’’ est le plus connu des dérivés atropiniques.
Origine
Originaire d’Asie, la Stramoine est répandue dans toute l’Europe fin du 16 ième siècle, en Afrique du Nord, en Amérique. On la trouve dans les lieux incultes au bord des chemins.
 Aspect
Aspect
Plante annuelle herbacée d’une hauteur de 1.20 mètre portant des feuilles d’un vert foncé brillant, avec des fleurs solitaires de grandes tailles.
Le fruit en forme de capsule ovoïde couverte d’épines rudes d’où le nom populaire de ‘’pomme épineuse’'.
Principes actifs
L’hyoscyamine, l’atropine, la scopolamine et l’hyoscine.
Usage le plus répandu
Le datura se consomme généralement par voie orale sous forme de décoction. Les graines peuvent aussi être ingérées seules, les feuilles peuvent être fumées (plus rare).
Effets recherchés
L’intensité des effets varie selon chaque personne, le contexte dans lequel elle consomme, la quantité consommée. Les usagers consomment le datura pour vivre une expérience introspective (pour faire un « voyage », un « trip »). Les effets recherchés sont :
• sensation de rêve éveillé : par exemple de parler à quelqu’un qui n’est pas présent, de manger quelque chose qui ne se mange pas voire n’existe pas
• puissantes hallucinations auditives, visuelles, tactiles (modification de la perception des couleurs, impression de s’enfoncer dans le sol, modification des formes…)
• perte des repères spatiotemporels
• insensibilité à la douleur.
Durée des effets :
Les effets surviennent une heure environ après ingestion et durent de 8 à 48 heures. Ils s’estompent petit à petit mais peuvent resurgir au cours de la semaine qui suit. Pour beaucoup, l’expérience est assez désagréable et laisse généralement peu de souvenirs.
Effets secondaires
Ces troubles sont très fréquents mais ils sont ressentis d’une manière différente d’un usager à l’autre :
• augmentation du rythme cardiaque
• tarissement de toutes les sécrétions : salive, sueur, larmes, sécrétions digestives
• sécheresse de la peau et des muqueuses, rougeur du visage
• tics nerveux
• état important de confusion avec perte d’équilibre
• augmentation de la pression intraoculaire, dilatation des pupilles et vision de près troublée
• relâchement des fibres musculaires lisses au niveau intestinal (transit ralenti), urinaire (rétention) et bronchique (dilatation des bronches).
A dose élevée le datura provoque une perte de contrôle de soi et des hallucinations qui peuvent exposer à des accidents graves.
Risques et complications
Dès la première consommation :

• hyperexcitation,
• agressivité,
• troubles de la vue pouvant durer plusieurs semaines,
• convulsions,
• comportement irrationnel exposant à des risques de blessures,
• complications d’ordre psychiatrique : hallucinations morbides, anxiété, attaques de panique
Risques de surdosage :
Le datura contient des alcaloïdes toxiques dont la consommation peut avoir des conséquences graves dès la première prise, comme le coma ou la mort par dépression respiratoire ou arrêt cardiaque. En effet, seulement 4 à 5 grammes de feuilles de datura peuvent contenir une dose mortelle d’alcaloïdes. Les fleurs et les graines sont encore plus puissantes.
Les effets du datura sur les pupilles s’observent jusqu’à trois semaines après une prise.
-
 1
1
-
-
-
Hey
on fume toujours trop, par contre on ne vapote jamais assez ....

Héhé

Bonne journée
@+
-
 1
1
-
-
Hey
en fait j'ai été poursuivie pour consommation détention production et incitation ... incitation c'est à cause des colloques qu'on organise pour les pro de santé à Strasbourg .... (eh oui on en est la ...)
et oui on peu être militant sans être consommateur, les pro de santé qui sont au CA de l'asso et qui nous soutiennent ne sont pas des stoners .... (loin de la .... ils préfèrent en général le bon vin ....) (ca ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais ete inquiété .... mais disons qu’actuellement ils s'en sont mieux sorti que le Dr Colombera au Luxembourg ....
@+
-
 2
2
-
 1
1
-
-
Hey
Merci de cette petite mise au point et au passage merci aussi pour ta réponse en message privé.
ceci étant dis maintenant que ta position est éclaircie ..... de mon point de vue, et j'insiste la dessus, je n’obéis pas et ne respecte pas une décision qui me met en danger (moi et de nombreux malades) je l'ai dis au tribunal, je respecte la loi française sauf si elle me condamne à mort et c'est le cas avec la loi de 70.
Pour répondre à une autre remarque qui a été faite :
".... pour ce qui est des médias, je dirais qu'en s'affichant à la télé il vaut mieux avoir du soutient derrière, parce que sinon ça n'a aucune chance de passer : thérapeutique ou pas, le cannabis est interdit en France, et ils ne vont pas se gêner pour te tomber dessus, pourquoi ils se gêneraient ? Tu enfreins la loi et tu le dis publiquement... "
c'est la base du militantisme, tu ne peux pas t'exprimer dans le cadre de leur loi, donc tu l'expliques mais même avec du soutien et crois moi j'avais du beton armé .... les juges obéissent au droit sans tenir compte d'une quelconque réalité mais juste parce qu'ils ne veulent pas être taxés de laxisme ..... oui la loi interdit l'usage du cannabis, mais la loi a 50 ans et la société a évolué grave en 50 ans je peux vous le garantir ....
les militants (thérapeutique) qui se sont affichés sont poursuivis ou l'on été sans aucunes considération du fait que leur consommation était directement liée à leurs problèmes de santé.
l'hypocrisie le manque de considération des usagers thérapeutiques et l'amalgame qui est continuellement fait n'arrangent rien .....
lorsque je suis passé au tribunal avec des attestations expliquant que sans le cannabis je serais mort, je dépendais alors de la loi sur l'etat de nécessité (c'est ce qui était plaidé par mes avocats) qui normalement est un texte de loi qui autorise à enfreindre une loi qui te met en danger ... Je réunissais trois des quatre points qui définissent l'etat de nécessité, le dernier point c'est que je ne mourrais pas assez vite .... je ne risquais pas de mourir dans la semaine mais dans les 6 mois et crois moi, ça fait mal au cul d'entendre un juge estimer que tu ne meurt pas assez vite pour bénéficier de ce texte de loi ....) .... Quand on en arrive la de l'application de la loi il y a un problème, on demande rien d'autre qu'un peu de justice, pas l'application rigoureuse et inhumaine d'un droit obsolete qui met les malades ou, au moins certains d'entre eux, en danger .....
C'est aussi pour ça que ça m'a un peu énervé cette histoire et de voir la réaction de Francky que je n'arrivais pas à comprendre ....
voila voila bah à pluche alors ....
@+

-
Re
c’était un exemple de personnes qui consomment du cannabis chez eux, n'emmerde personne et risque la prison ...
maintenant si tu veux une histoire vraie qui colle a tes propos :
parce que je suis passé dans les medias j'ai été arrêté dans la rue alors que je marchais sans consommer quoi que se soit ......
l’équipage de CRS (bah oui normal ils sont la pour ça hein ....) qui est monté sur le trottoir avec la camionnette pour me barrer la route, comme si j'etais l'enemi public number ouane, on du juste me reconnaitre ....
deux ans de procédure, trois passages au tribunal, et crois moi si j'ai pas été en prison c'est juste parce que j'avais 11 attestations dont l'une d'un ancien ministre de l’intérieur qui "garantissait" ma bonne moralité ..... les 10 autres étaient des attestations de pro de santé "class internationale" soutien de Californie de suisse d’Allemagne plus les pro de santé qui me suivent .... donc que les consommateur qui ne consomment pas dans la rue ne serait pas inquiété et ne passerais pas au tribunal ça n'existe pas. et ta theorie sur ceux qui passent dans les medias et à qui rien n'arrive non plus.
excuse moi donc de t'avoir mal compris mais comme tu semblais dire qu'à partir du moment ou tu es sur la voie publique l'amende peut se justifier ...

-
Hey
@FranckyVincent
hé non, les malades qui ont vu les flics débarqués ont juste été balancés par leurs voisins, c'est ballot hein ..... fais attention on ne sait jamais ..... pas d'apologie, juste l'application du droit inique et cynique qui est celui qui s'applique à nous ....
je ne sous entend rien ... je constate et j'explique une situation point barre .... par ailleurs puisque tu es d'accord avec ce système pourquoi la deuxième arrestation ça sera plus une simple amende, pas de récidive c'est clairement la création d'un fichier.
on n'est pas d'accord c'est vrai .... mais bon, ça me rassure d’être d'accord avec l'ensemble des associations qui militent pour la sortie de prohibition, avec la fédération addiction et tout les pro de santé qui expliquent à quel point cette idée n'a aucun sens, et aussi avec des maitres de conférence en droit (spécialistes du droit des drogues) avec qui j'ai eu l'occasion de discuté de la legalisation plutot qu'avec toi, ne m'en veux pas c'est juste du pragmatisme .....
@+

-
Hey
[...]dans la situation actuelle, l'état ne peut pas passer d'une situation de prohibition et de répression totale à la situation diamétralement opposée qu'est la légalisation. De ce fait, l'état ne peut procéder que pas à pas. [...]
ah bon et la seule solution c'est donc de rajouter de la répression .... Ok j'avais pas capté ....
Il y avait un vrai débat à ouvrir, bien sur il n'est pas question de passer de l'un a l'autre sans étapes, mais ajouter une étapes supplémentaire qu'il faudra déboiter pour aller de l'avant ne me parait pas être la meilleure solution ....
la contraventionalisation c'est tout sauf une avancée, tout sauf une bonne idée ....Rien de positif ....
"Mais si je ne m'abuse, ces dernières années, beaucoup de monde en parle positivement de manière publique, notamment sur les médias, sans être menacé d'être envoyé en prison comme tu le dis! "
Re ah bon ....
faudra expliquer ça aux malades qui ont été trainés devant les tribunaux, à ceux qui ont du, avec l'état d'urgence, voir la police débarquer à 6 heure du matin pour sortir une personne handicapée du lit et lui mettre tellement la pression qu'en comparution immédiate c'est 3000 euros d'amendes et 3 mois de sursis ....
trop top, maintenant il n'y aura pas la justice, juste la décision d'un représentant des forces de l'ordre qui décidera seul s'il condamne ou s'il ne condamne pas ..
penser que les contraventions vont changer ça et améliorer les choses c'est un peu être resté à bisounoursville (désolé ....)
@+

-
 1
1
-
-
Hey
éduquer ....
après je suis un peu comme Demourok niveau compréhension du message ....
Il m'arrive de consommer dehors, pas par plaisir ou parce que je veux provoquer, mais je ne peux juste pas prévoir certains aspects de la maladie et les pics de douleurs qui l'accompagnent .... Après je ne consomme pas dans la rue, je m'isole le plus possible pour gener personne et pour pas risquer l'arrestation, mais si un policier venait, je refuse sa contravention et je demande la justice pas le jugement d'un homme qui va me condamner d'office ....
@+

-
Hey
un petit article sur le souci
Bonne lecture
@+

Souci

Noms communs : Souci officinal, souci des jardins.
Nom botanique : Calendula officinalis, famille des astéracées ou composées.
Noms anglais : Marigold, pot marigold.Partie utilisée : Les fleurs, récoltées en été, dès leur éclosion.
Habitat et origine : Originaire d'Europe méridionale, le souci est depuis longtemps cultivé sous tous les climats tempérés. C'est une annuelle peu exigeante en matière de sol.Indications
Traiter les inflammations de la peau et des muqueuses de la bouche et de la gorge, les plaies et les ulcères variqueux.
Par voie interne – Traiter la jaunisse; soulager les douleurs menstruelles; régulariser le cycle féminin; combattre les infections et les inflammations du système digestif, l’ulcère gastroduodénal et les spasmes gastro-intestinaux.
Par voie externe – traiter les blessures et les infections cutanées, les brûlures, l'eczéma et la conjonctivite.
Posologie du souci
Par voie interne
Troubles digestifs, hépatiques et menstruels
- Fleurs séchées. Prendre de 1 g à 2 g de fleurs séchées par jour.
- Infusion. Plonger de 1 g à 2 g de fleurs séchées dans 150 ml d'eau bouillante pendant 5 à 10 minutes. Prendre 1 tasse, 3 fois par jour, durant 2 semaines au maximum.
- Extrait liquide (1 :1 dans de l’éthanol à 40 %). Prendre de 0,5 ml à 1 ml 3 fois par jour.
- Teinture (1 :5 dans de l’éthanol à 90 %). Prendre de 0,5 ml à 1 ml, 3 fois par jour.
Par voie externe
Inflammation de la peau, blessure, brûlure, ulcère variqueux, abcès, eczéma
- Appliquer localement la teinture ou l'infusion préalablement refroidie. On peut aussi faire une compresse avec l'infusion ou la teinture diluée à 1:3 dans de l'eau préalablement bouillie et refroidie. Répéter au besoin. On peut également utiliser une huile, une crème ou un onguent contenant de 2 % à 5 % de fleurs.
Inflammation des muqueuses de la bouche et de la gorge
- Rince-bouche ou gargarisme avec l'infusion ou avec une dilution de 2 ml à 4 ml de teinture par 250 ml d'eau. Répéter au besoin.
Historique du souci
Le souci était déjà utilisé en cuisine, en médecine et en cosmétique par les civilisations indiennes, arabes et grecques de l’antiquité. On tirait des fleurs une teinture jaune pour les textiles. Elles étaient aussi employées en cuisine sous le nom de « safran des pauvres », pour ajouter de la couleur et du goût à certains plats.
On cultive la plante dans les jardins d'Europe depuis le XIIe siècle. Elle servait à déclencher les menstruations, à favoriser la sudation en cas de fièvre et à traiter la jaunisse. Au XIXe siècle, les Éclectiques, un groupe de médecins américains qui utilisaient les plantes en conjonction avec les médicaments officiels, employaient le souci pour traiter les ulcères de l’estomac et du duodénum, la jaunisse, la conjonctivite, les brûlures et les lésions superficielles de la peau.
Recherches sur le souci
 La Commission E, l'ESCOP et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) reconnaissent les usages interne et externe du souci pour traiter les inflammations de la muqueuse de la bouche et de la gorge, ainsi que pour soigner les lésions de la peau (plaies, brûlures, ecchymoses, etc.) et les ulcères variqueux.
La Commission E, l'ESCOP et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) reconnaissent les usages interne et externe du souci pour traiter les inflammations de la muqueuse de la bouche et de la gorge, ainsi que pour soigner les lésions de la peau (plaies, brûlures, ecchymoses, etc.) et les ulcères variqueux.
Il existe peu d’études permettant de confirmer les effets curatifs du souci sur la peau. En 2001, des chercheurs ont observé qu'une huile à base de millepertuis et de Calendula arvensis (un proche parent du souci officinal) améliorait la guérison des plaies chirurgicales de femmes ayant subi une césarienne3. En 2005, des résultats identiques ont été obtenus avec un onguent à base de souci utilisé sur des patients souffrant d’ulcères variqueux4. Les mécanismes d’action sont encore mal connus, mais le souci contient des substances anti-inflammatoires2 et il accélère l'épithélisation1, 13.
Les propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes du souci protégeraient aussi la peau contre les radiations, solaires ou autres. En 2004, une étude sur des femmes atteintes d’un cancer du sein a montré qu’une pommade à base de souci était plus efficace que l’onguent habituellement utilisé, la Biafine®, pour prévenir la dermite (une inflammation de la peau) causée par la radiothérapie et pour réduire la douleur5. En 2010, l’administration d’extrait de souci à des souris exposées à des rayons UV-B a permis d’en réduire les effets sur leur peau14.
On a observé que des crèmes à base de souci et de romarin pouvaient prévenir la dermite causée par le laurylsulfate de sodium, un composant de plusieurs savons et shampoings6.
 Inflammation gastrique. Au cours d'essais cliniques non contrôlés, des patients souffrant de colite chronique ont vu leurs douleurs disparaître grâce à une préparation à base de pissenlit, de millepertuis, de mélisse, de souci et de fenouil7. D’autres, souffrant d'ulcère duodénal ou de gastroduodénite (inflammation de l'estomac et du duodénum) ont été soulagés par une préparation contenant du souci et de la consoude8.
Inflammation gastrique. Au cours d'essais cliniques non contrôlés, des patients souffrant de colite chronique ont vu leurs douleurs disparaître grâce à une préparation à base de pissenlit, de millepertuis, de mélisse, de souci et de fenouil7. D’autres, souffrant d'ulcère duodénal ou de gastroduodénite (inflammation de l'estomac et du duodénum) ont été soulagés par une préparation contenant du souci et de la consoude8.
Au cours d'une étude sur des rats et des souris, des chercheurs japonais ont constaté que certains composés d'un extrait de souci possédaient une activité hypoglycémiante, mais aussi un effet protecteur sur l'estomac9.
Divers. Au cours d'une étude menée en 2001 auprès d’enfants de 6 ans à 18 ans atteints d'otite moyenne aiguë, des chercheurs ont constaté qu'une préparation à base d'huile d'olive, d'ail, de molène, de souci et de millepertuis était aussi efficace pour soulager la douleur que la préparation analgésique classique à base d'amétocaïne et de phénazone10.
Précautions
Attention
- Ne pas confondre le souci (Calendula officinalis) avec les plantes suivantes : le tagète (Tagetes) que les Anglais nomment également Marigold et le souci d'eau (Caltha palustris), une plante appartenant à une tout autre famille botanique (renonculacées).
Contre-indications
- Aucune connue.
Effets indésirables
- Au cours de certaines expériences, on a observé de légères réactions cutanées, mais aucun cas de dermatite de contact n'a été rapporté. Malgré un usage extrêmement répandu, un seul cas de réaction anaphylactique a été rapporté en Russie.
- Il y a un risque plus grand d'allergie chez les personnes allergiques ou sensibles aux plantes de la famille des composées (astéracées), telles que la marguerite, le pissenlit, l’échinacée, etc.
Interactions
Avec des plantes ou des suppléments
- Sur la base d’essais menés en 1964 sur des animaux, il se pourrait que de hautes doses de souci, prises par voie interne, augmentent l'effet de plantes sédatives ou calmantes (valériane, houblon, par exemple).
Avec des médicaments
- Sur la base d’essais menés sur des animaux, il se pourrait que de hautes doses de souci, prises par voie interne, augmentent l'effet des médicaments prescrits pour combattre l'anxiété et l'insomnie.

Réviseure :
Danielle Julie Carrier, professeure agrégée, Génie biologique et agricole, Université d’Arkansas (avril 2010).Recherche et rédaction : Équipe PasseportSanté.net
Mise à jour : avril 2010
Références
Note : les liens hypertextes menant vers d'autres sites ne sont pas mis à jour de façon continue. Il est possible qu'un lien devienne introuvable. Veuillez alors utiliser les outils de recherche pour retrouver l'information désirée.
Bibliographie
Barnes J., Anderson L.A. David Phillipson J. Herbal Medicines (Second edition). Pharmaceutical Press, 2002.
Blumenthal M. (Edi). The Complete Commission E Monographs : Calendula flower + Calendula herb. American Botanical Council, Boston. 1998.
Chevallier A. Encyclopédie des plantes médicinales. Sélection Readers Digest, Montréal, 1997.
ESCOP Monographs on the Medicinal Uses of Plants Drugs. Calendulae flos. Centre for Complementary Health Studies, University of Exeter, United Kingdom, 1999.
National Library of Medicine (Ed). PubMed, NCBI. [Consulté le 25 mars 2010]. www.ncbi.nlm.nih.gov
Natural Standard (Ed). Foods, Herbs & Supplements – Calendula, Nature Medicine Quality Standard. [Consulté le 25 mars 2010]. www.naturalstandard.com
Organisation mondiale de la santé. WHO monographs on selected medicinal plants, vol. 2, Suisse, 2002.
Santé Canada – Base de données d’ingrédients de produits de santé naturels. Calendule – Orale. [Consulté le 30 mars 2010] www.sc-hc.gc.ca
The Natural Pharmacist (Ed). Natural Products Encyclopedia, Herbs & Supplements - Calendula, ConsumerLab.com. [Consulté le 25 mars 2010]. www.consumerlab.comNotes
1. ESCOP Monographs on the Medicinal Uses of Plants Drugs. Calendulae flos. Centre for Complementary Health Studies, University of Exeter, United Kingdom, 1999.
2. Della Loggia R, Tubaro A, et al. The role of triterpenoids in the topical anti-inflammatory activity of Calendula officinalis flowers.Planta Med 1994 Dec;60(6):516-20
3. Lavagna SM, Secci D, et al. Efficacy of Hypericum and Calendula oils in the epithelial reconstruction of surgical wounds in childbirth with caesarean section.Farmaco 2001 May-Jul;56(5-7):451-3
4. Duran V, Matic M, et al. Results of the clinical examination of an ointment with marigold (Calendula officinalis) extract in the treatment of venous leg ulcers. Int J Tissue React. 2005;27(3):101-6.
5. Pommier P, Gomez F, et al. Phase III randomized trial of Calendula officinalis compared with trolamine for the prevention of acute dermatitis during irradiation for breast cancer. J Clin Oncol. 2004 Apr 15;22(8):1447-53.
6. Fuchs SM, Schliemann-Willers S, et al. Protective effects of different marigold (Calendula officinalis L.) and rosemary cream preparations against sodium-lauryl-sulfate-induced irritant contact dermatitis. Skin Pharmacol Physiol. 2005 Jul-Aug;18(4):195-200. Epub 2005 May 20.
7. Chakurski I, Matev M, et al. [Treatment of chronic colitis with an herbal combination of Taraxacum officinale, Hipericum perforatum, Melissa officinaliss, Calendula officinalis and Foeniculum vulgare] [Article en bulgare, résumé en anglais] Vutr Boles 1981;20(6):51-4
8. Chakurski I, Matev M, et al. Treatment of duodenal ulcers and gastroduodenitis with a herbal combination of Symphitum officinalis and Calendula officinalis with and without antacids.Vutr Boles. 1981;20(6):44-7.
9. Yoshikawa M, Murakami T, et al. Medicinal flowers. III. Marigold. (1): hypoglycemic, gastric emptying inhibitory, and gastroprotective principles and new oleanane-type triterpene oligoglycosides, calendasaponins A, B, C, and D, from Egyptian Calendula officinalis.Chem Pharm Bull (Tokyo) 2001 Jul;49(7):863-70
10. Sarrell EM, Mandelberg A, Cohen HA. Efficacy of naturopathic extracts in the management of ear pain associated with acute otitis media.Arch Pediatr Adolesc Med 2001 Jul;155(7):796-9.
11. Bojadjiev C. On the sedative and hypotensive effect of preparations from the plant Calendula officinalis. Nauch Trud Visshi Med Inst Sof 1964;43:15-20. Étude citée dans : Brinker F (Ed). Herb contraindications and Drug interactions, Eclectic Medical Publications, États-Unis, 1998, pages 46 et 208.
12. Samochowiec L. Pharmacological study of saponosides From Aralia manshurica Rupr. Et Maxim and Calendula Officinalis. Herba Pol 29:151-5,1983. Étude citée dans : Brinker F (Ed). Herb contraindications and Drug interactions, Eclectic Medical Publications, États-Unis, 1998, pages 46 et 208.
13. Wound healing activity of flower extract of Calendula officinalis. Preethi KC, Kuttan R. J Basic Clin Physiol Pharmacol. 2009;20(1):73-9.
14. Protective effect of Calendula officinalis extract against UVB-induced oxidative stress in skin: evaluation of reduced glutathione levels and matrix metalloproteinase secretion. Fonseca YM, Catini CD, et al. J Ethnopharmacol. 2010 Feb 17;127(3):596-601.-
 1
1
-
 1
1
-
Hey
Bah je vais ajouter l'article de l'huma qui donne la parole à plusieurs personalités addicto pro de santé et droit ....
Bonne lecture
@+

https://humanite.fr/la-contravention-pour-usage-de-cannabis-est-elle-une-reponse-adaptee-649722
La contravention pour usage de cannabis est-elle une réponse adaptée ?
Après la promesse électorale.Jeudi, 1 Février, 2018L'HumanitéUne amende forfaitaire : c’est ce que préconise un rapport parlementaire pour sanctionner les consommateurs et « recentrer le travail » de la police sur la lutte contre le trafic.
Lire les points de vue de Renaud Colson, maître de conférences de droit à l’université de Nantes, Bernard Basset, vice-président de l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, Béatrice Stambul, psychiatre, co-initiatrice de l’Appel de Marseille pour une légalisation contrôlée du cannabis et Bertrand Dautzenberg, praticien hospitalier à l’AP-HP Pitié-Salpêtrière et à l’hôpital Marmottan.-
Une mesure à côté de la plaque par Bernard Basset, vice-président de l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie
 Le rapport des deux députés Éric Pouillat (LREM) et Robin Reda (LR), rendu public récemment, répondait à une commande pour mettre en œuvre la promesse présidentielle de contraventionnalisation de l’usage de cannabis, une drogue consommée massivement, mais aussi des autres stupéfiants. Cette promesse avait été formulée dans le cadre de la communication calibrée d’une campagne électorale, sans que les objectifs ou les modalités de mise en œuvre en aient été précisés. C’est pourquoi les deux parlementaires se sont trouvés dans une relative impasse. Incapables de définir les axes d’une politique de lutte contre les addictions, ils ont été réduits à justifier la contraventionnalisation par le seul objectif de rationalisation des ressources humaines des policiers et des juges. Et encore cette proposition « petit bras » risque fort d’être inopérante, tout en laissant un marché lucratif à des réseaux criminels.
Le rapport des deux députés Éric Pouillat (LREM) et Robin Reda (LR), rendu public récemment, répondait à une commande pour mettre en œuvre la promesse présidentielle de contraventionnalisation de l’usage de cannabis, une drogue consommée massivement, mais aussi des autres stupéfiants. Cette promesse avait été formulée dans le cadre de la communication calibrée d’une campagne électorale, sans que les objectifs ou les modalités de mise en œuvre en aient été précisés. C’est pourquoi les deux parlementaires se sont trouvés dans une relative impasse. Incapables de définir les axes d’une politique de lutte contre les addictions, ils ont été réduits à justifier la contraventionnalisation par le seul objectif de rationalisation des ressources humaines des policiers et des juges. Et encore cette proposition « petit bras » risque fort d’être inopérante, tout en laissant un marché lucratif à des réseaux criminels.
En effet, les dealers se sont déjà adaptés à la menace de contrôle des points focaux de distribution dans certains quartiers : ils livrent de plus en plus sur commande, au moyen de coursiers à domicile, font des promotions pour fidéliser leurs clients, etc. La contraventionnalisation s’attaque donc à un mode de distribution qui est en train de disparaître, au profit d’un nouveau plus difficilement traçable par la police.
Enfin, l’expérience de la difficulté générale de recouvrement des amendes devrait faire réfléchir à la faisabilité de la mesure, par ailleurs socialement discriminante. Le constat actuel est que les contrôles se font dans les quartiers défavorisés, sur une jeunesse souvent en situation de précarité, plutôt que dans les lycées des beaux quartiers, qui consomment tout autant.
L’abandon de ce marché aux réseaux criminels a, de plus, des conséquences négatives pour le consommateur : aucune garantie quant à la composition de ce qui lui est vendu, aucune information fiable sur la teneur en principe actif, une insécurité du fait de la fréquentation de réseaux criminels.
Enfin, et c’est le plus dommageable, la proposition de contraventionnalisation remplace le débat nécessaire sur une politique de santé publique sur les addictions, que d’autres pays mènent courageusement et sans tabou. Le constat est universel et indiscuté : il n’y a pas de société sans drogue. Dès lors, l’intervention des pouvoirs publics doit se centrer sur la limitation des dommages, et en particulier de ceux qui touchent les jeunes et obèrent leurs chances d’insertion ou de réussite sociale.
Le cannabis ne doit pas être considéré comme un produit psychoactif anodin pour les jeunes malgré sa banalisation et sa consommation de masse. Comme tout produit psychoactif (c’est aussi le cas de l’alcool, également fortement consommé), les conséquences sur un cerveau en phase de maturation ne peuvent être favorables, et de plus en plus d’études soulignent les conséquences négatives sur l’apprentissage et les performances scolaires. La contravention n’y répondra en aucune manière.
Dès lors, comme d’autres pays plus réalistes (Uruguay, Canada, Californie…), l’intervention efficace pour réduire les dommages ne peut passer que par la régulation d’un marché officiel, légal. Ce cadre offrirait la possibilité de surveiller la distribution, de contrôler (et de limiter) la teneur en principe actif, d’avoir une politique de prix via les taxes, d’interdire réellement la vente aux mineurs et d’informer sur les risques de produits bien définis, sans compter le bénéfice sécuritaire par l’assèchement de l’économie souterraine.
-
Une disposition timorée, une fausse bonne idée par Béatrice Stambul, psychiatre, co-initiatrice de l’Appel de Marseille pour une légalisation contrôlée du cannabis
 Alors qu’enfin, en France, le débat public sur le statut du cannabis perce timidement, alors que, dans le monde, des États dépénalisent son usage et que d’autres en légalisent la production et la consommation, le gouvernement français propose, sans discussion ni concertation avec les professionnels, un projet nébuleux de contravention pour les consommateurs. Présenté comme une approche simplifiée et innovante, ce projet se révèle, à l’étude, inapproprié et inefficace au vu des enjeux du problème. Conserver en 2018 une pénalisation de l’utilisation du cannabis révèle une vision archaïque, moralisante et inopérante de la question. Interdire et punir n’ont jamais eu d’effet sur les pratiques, et pour exemple, la France, pays très répressif sur la consommation, est le pays d’Europe où elle est la plus élevée (17 millions de Français, selon l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, affirment avoir déjà consommé du cannabis). Alléguer de la « dangerosité » de la substance pour maintenir la prohibition relève de la croyance plutôt que d’une politique fondée sur des preuves. Des produits beaucoup plus dangereux comme le tabac et l’alcool, de nombreux médicaments sont, eux, légaux, et c’est par la réglementation qu’on en encadre la commercialisation.
Alors qu’enfin, en France, le débat public sur le statut du cannabis perce timidement, alors que, dans le monde, des États dépénalisent son usage et que d’autres en légalisent la production et la consommation, le gouvernement français propose, sans discussion ni concertation avec les professionnels, un projet nébuleux de contravention pour les consommateurs. Présenté comme une approche simplifiée et innovante, ce projet se révèle, à l’étude, inapproprié et inefficace au vu des enjeux du problème. Conserver en 2018 une pénalisation de l’utilisation du cannabis révèle une vision archaïque, moralisante et inopérante de la question. Interdire et punir n’ont jamais eu d’effet sur les pratiques, et pour exemple, la France, pays très répressif sur la consommation, est le pays d’Europe où elle est la plus élevée (17 millions de Français, selon l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, affirment avoir déjà consommé du cannabis). Alléguer de la « dangerosité » de la substance pour maintenir la prohibition relève de la croyance plutôt que d’une politique fondée sur des preuves. Des produits beaucoup plus dangereux comme le tabac et l’alcool, de nombreux médicaments sont, eux, légaux, et c’est par la réglementation qu’on en encadre la commercialisation.
En termes de santé publique, nous, professionnels du soin, le savons bien, criminaliser une conduite éloigne les personnes en difficulté des structures d’aide, favorise la clandestinisation des pratiques et les prises de risques. Les produits utilisés sont habituellement coupés avec des substances inconnues parfois dommageables pour la santé.
Sur le plan de l’ordre public, on entend des responsables politiques se réjouir de la simplification des procédures. Pourtant cette proposition ne va pas toucher au trafic et à ses multiples dommages collatéraux, ses règlements de comptes qui devraient être une priorité de nos dirigeants. La poursuite des dealers concerne beaucoup plus « le petit poisson » que les gros trafiquants. La guerre à la drogue se double souvent d’une guerre raciale dont les jeunes des quartiers, souvent issus de l’immigration, font les frais.
Le rapport coût-efficacité est présenté comme amélioré, mais l’argent investi dans la lutte contre le trafic reste infiniment supérieur aux budgets de la prévention et du soin.
Enfin, il faut poser la question du droit des gens qui consomment, en finir avec la stigmatisation dont ils sont l’objet, le rôle de bouc émissaire qu’on leur fait porter. On allège la punition mais on condamne toujours, on discrimine.
Il fallait une mesure utile et efficace. La légalisation contrôlée, comme en Uruguay, dans plusieurs États des États-Unis et au Canada, était la bonne réponse. Notre gouvernement n’a eu ni le courage ni l’intelligence de le faire.
-
L’instauration de l’amende pénale est acceptable par Bertrand Dautzenberg, praticien hospitalier à l’AP-HP Pitié-Salpêtrière et à l’hôpital Marmottan
 Alors que, depuis la loi Evin, la consommation de tabac par Français a diminué de 50 %, celle de l’alcool de 30 %, la consommation de cannabis a augmenté de 60 % ! La prohibition est un échec ! Les 4/5es des Français disent que la situation actuelle du cannabis en France n’est plus tenable. S’il existe un consensus pour penser que la situation doit évoluer, la nature de l’évolution ne fait pas l’objet d’un consensus car le problème est complexe, fait intervenir de nombreux paramètres et aucune solution n’est pleinement satisfaisante, même si elles sont quasiment toute moins pires que l’immobilité. Ceux qui n’acceptent qu’une solution tranchée tout noir ou tout blanc aggravent consommation et dangers. Toute solution a des avantages et des inconvénients et dépend des sous-priorités de chacun des acteurs, même si l’objectif final : réduire la consommation et la dangerosité du cannabis, est partagé par la très grande majorité des Français.
Alors que, depuis la loi Evin, la consommation de tabac par Français a diminué de 50 %, celle de l’alcool de 30 %, la consommation de cannabis a augmenté de 60 % ! La prohibition est un échec ! Les 4/5es des Français disent que la situation actuelle du cannabis en France n’est plus tenable. S’il existe un consensus pour penser que la situation doit évoluer, la nature de l’évolution ne fait pas l’objet d’un consensus car le problème est complexe, fait intervenir de nombreux paramètres et aucune solution n’est pleinement satisfaisante, même si elles sont quasiment toute moins pires que l’immobilité. Ceux qui n’acceptent qu’une solution tranchée tout noir ou tout blanc aggravent consommation et dangers. Toute solution a des avantages et des inconvénients et dépend des sous-priorités de chacun des acteurs, même si l’objectif final : réduire la consommation et la dangerosité du cannabis, est partagé par la très grande majorité des Français.
Si on se place du côté de la justice et de la police : la pénalisation de la simple consommation est bafouée chaque minute en France. Qui appliquerait par exemple l’article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale, qui énonce « que tout fonctionnaire… qui acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République ». Bien heureusement, la loi n’est jamais appliquée ; mais le bon sens voudrait qu’une loi jamais appliquée doive être abrogée ou réécrite.
La police et la justice sont débordées par la pénalisation de la consommation de cannabis et demandent à être soulagées de tâches inutiles, voire nuisibles, à l’intérêt général.
Le débat récent aurait pu conduire à mettre au plus bas niveau la réponse des autorités à l’interdiction du cannabis : la contravention. Ceci aurait traduit une dépénalisation.
Le choix a été fait de maintenir la pénalisation, la consommation de cannabis restant un délit. Le seul changement est de permettre que ce délit pénal puisse se traduire par une amende. Cette amende n’est pas délivrée dans le cadre d’une infraction, mais dans le cadre d’un délit et n’éteint pas de façon automatique l’action pénale.
Pour la police et la justice, cette mesure peut se traduire comme une simplification libérant du temps de policier et de professionnel de la justice : c’est donc pour eux une bonne décision.
Pour les consommateurs, cette mesure, si elle est appliquée correctement, peut faire régresser le sentiment d’impunité en remplaçant une sanction théorique inappliquée par une mesure bien réelle. Elle peut aussi déclencher un changement de comportement : arrêt de consommation ou adoption de règles pour moins consommer et moins transporter de cannabis sur la voie publique.
Pour le médecin, cette amende pénale pour consommation de cannabis ne fait pas espérer d’effet positif ou craindre d’effet négatif. Tout dépendra de l’application. La légalisation du cannabis serait la seule mesure qui permettrait réellement de faire régresser la consommation, si elle était conduite avec un pilotage « santé publique ». Mais le cheminement vers la légalisation contrôlée au nom de la santé publique nécessite du temps.
L’instauration d’une amende pénale est acceptable car elle ne va pas contre cet objectif de réduction de la consommation et donc des méfaits du cannabis. Espérons que l’argent collecté par ces amendes pénales servira à financer un fonds anti-cannabis, comme a été financé un fonds anti-tabac depuis l’an dernier.
-
Un toilettage législatif par Renaud Colson, maître de conférences de droit à l’université de Nantes
 Le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, a confirmé la volonté du gouvernement de forfaitiser la sanction du délit d’usage de stupéfiants. La consommation illicite de drogue conservera le caractère d’une infraction délictuelle passible d’un an de prison, mais les forces de l’ordre disposeront du pouvoir discrétionnaire de prononcer une amende en lieu et place de la procédure judiciaire aujourd’hui requise. Cette peine pécuniaire infligée par un policier ou un gendarme se substituera, le cas échéant, à la réponse pénale ou sanitaire, théoriquement individualisée, ordonnée par le magistrat. La vaste majorité des usagers de cannabis pris dans les rets du système pénal, et qui font aujourd’hui l’objet d’un simple rappel à la loi, d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ou d’une injonction de soins, se verront ainsi désormais imposer une sanction financière. Le montant de l’amende (probablement aux alentours de 200 euros) ne prendra pas en compte le niveau de revenu du contrevenant, et les modalités de son paiement ne pourront être aménagées.
Le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, a confirmé la volonté du gouvernement de forfaitiser la sanction du délit d’usage de stupéfiants. La consommation illicite de drogue conservera le caractère d’une infraction délictuelle passible d’un an de prison, mais les forces de l’ordre disposeront du pouvoir discrétionnaire de prononcer une amende en lieu et place de la procédure judiciaire aujourd’hui requise. Cette peine pécuniaire infligée par un policier ou un gendarme se substituera, le cas échéant, à la réponse pénale ou sanitaire, théoriquement individualisée, ordonnée par le magistrat. La vaste majorité des usagers de cannabis pris dans les rets du système pénal, et qui font aujourd’hui l’objet d’un simple rappel à la loi, d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ou d’une injonction de soins, se verront ainsi désormais imposer une sanction financière. Le montant de l’amende (probablement aux alentours de 200 euros) ne prendra pas en compte le niveau de revenu du contrevenant, et les modalités de son paiement ne pourront être aménagées.
On ne peut que spéculer sur les effets d’une telle réforme, mais on peut raisonnablement supposer qu’ils seront marginaux. Le rapport de la mission parlementaire récemment rendu sur le sujet annonce que les gains de temps et de moyens humains accompagnant la simplification procédurale envisagée seront très limités. Quant à l’amende forfaitaire, son champ d’application sera singulièrement réduit puisqu’elle ne concernera que les primo-délinquants, à l’exclusion des mineurs, et des usagers en situation de récidive légale. Sous couvert de réaffirmer l’interdit pénal, le projet gouvernemental aboutit à donner au délit d’usage de stupéfiants le visage d’une modeste contravention sanctionnée automatiquement par les forces de l’ordre sans médiation judiciaire, le juge étant exclu de facto de la procédure. Ce transfert de pouvoir de la justice vers la police constitue sans doute la conséquence la plus remarquable mais également la plus discutable de la réforme projetée.
À l’inverse du législateur de 1970, pour qui la punition de l’utilisateur de drogue devait être réservée au toxicomane endurci rétif à tout traitement, le gouvernement, constatant l’impossible « désintoxication » des millions d’usagers récréatifs de cannabis, réclame leur sanction systématique. Il existe, certes, quelques mauvaises raisons de simplifier la procédure de sanction de l’usage de stupéfiants. La satisfaction statistique d’élucider à l’infini des infractions sans victime se double de la perspective de juteuses rentrées d’argent. Mais si l’objectif est bien de lutter contre le fléau des addictions, une autre approche, moins méprisante des fonctions essentielles de la police et plus respectueuse des droits humains, doit être envisagée. Du Portugal aux Pays-Bas, en passant par de nombreux États d’Amérique, s’expérimentent des politiques de santé publique qui mettent l’accent sur la prévention et sur la réduction des risques liés à la consommation de drogue plutôt que sur sa pénalisation. Comparés à la France, les niveaux d’usage de stupéfiants y sont souvent beaucoup plus faibles. C’est dans cette direction qu’il convient d’avancer, plutôt que dans celle d’un toilettage législatif qui, sous couvert d’adaptation de la loi au réel, opte pour la sanction automatique de tous les consommateurs de drogue et l’abandon des toxicomanes à leur fragilité.
Renaud Colson
Maître de conférences de droit à l’université de Nantes
Bernard Basset
Vice-président de l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie
Béatrice Stambul
Psychiatre, co-initiatrice de l’Appel de Marseille pour une légalisation contrôlée du cannabis
Bertrand Dautzenberg
Praticien hospitalier à l’AP-HP Pitié-Salpêtrière et à l’hôpital Marmottan
https://humanite.fr/la-contravention-pour-usage-de-cannabis-est-elle-une-reponse-adaptee-649722
-
 5
5
-
 1
1
-
-
Hey
bah pour moi c'est reveil en douceur ....
enjoy
@+

-
 1
1
-
-
hello
le kava
bonne lecture
@+

https://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=kava_ps
Kava
Noms communs : kava, kawa, ava, awa, poivre intoxicant.
Nom botanique : Piper methysticum, famille des pipéracées.
Nom anglais : kava kava.Parties utilisées : Racine et rhizomes.
Habitat et origine : Le kava est un arbuste, membre de la famille du poivrier, originaire des îles du Pacifique (Polynésie, Micronésie, Mélanésie, Hawaï) où les indigènes le cultivent depuis longtemps en raison des vertus particulières de ses racines. Cet arbuste ne se reproduit que par méthode végétative, ce qui demande une intervention humaine.Le 21 août 2002, Santé Canada a interdit la vente de tous les produits contenant du kava. Cette interdiction fait suite à des rapports associant l'utilisation du kava à de graves troubles hépatiques, dont trois cas mortels. Consulter dans cette fiche les sections Historique, Précautions et L'avis de notre pharmacien pour en savoir plus sur cette décision controversée.
Indications
En traitement

Réduire l’anxiété

Réduire l’insomnie et le stress, réduire les troubles moteurs de type parkinsonien

Favoriser la détente et les contacts sociaux durant des cérémonies rituelles
Posologie
On mesure le dosage d'un produit à base de kava en fonction de sa teneur en kavalactones, les substances actives de la racine (on les nomme également kavapyrones), laquelle doit être inscrite sur l'emballage. La teneur en kavalactones des divers extraits du commerce peut varier de 30 % à 70 %.
Anxiété, stress, agitation
- Extrait normalisé (30 % de kavalactones). Prendre de 100 mg à 230 mg trois fois par jour, soit de 30 mg à 70 mg de kavalactones par dose. Commencer avec le dosage le plus faible.
Des solutions de rechange au kava?
Si vous résidez dans un pays où la vente de kava est désormais interdite, il existe d'autres plantes qui peuvent soulager l'anxiété et l'insomnie :
- le houblon
- la passiflore
- le millepertuis
- la valérianeHistorique
Depuis des milliers d'années, les indigènes des îles du Pacifique tirent de la racine du kava une boisson qui améliore l'humeur et prédispose à la socialisation. Le capitaine James Cook fut le premier à relater cet usage traditionnel dans les récits qu'il fit de son périple dans les îles du Sud (1768-1771). Malgré les efforts des missionnaires chrétiens pour éradiquer la consommation de la boisson de kava, on trouve encore aujourd'hui des « bars à kava » sur certaines îles d'Océanie. Dans ces endroits, on accueille souvent les dignitaires étrangers en les gratifiant d'une cérémonie au cours de laquelle on procède à la consommation rituelle de la boisson de kava qui favoriserait des relations sociales harmonieuses.
Les herboristes allemands utilisèrent la racine de kava dès le XIXe siècle et, en 1990, la Commission E d'Allemagne a approuvé la racine de kava pour le traitement de l'anxiété et de l'agitation nerveuse. En 1998, certains rapports médicaux ont fait mention d'incidents hépatotoxiques liés à l'usage du kava. À l'automne 2001, les autorités européennes envisageaient de revoir la réglementation concernant le kava : quatre cas d'hépatoxicité étaient signalés en Suisse et 24 en Allemagne, dont trois mortels. Une transplantation du foie a été nécessaire chez quatre personnes.
En Belgique et en Hollande, on s'est contenté d'aviser les consommateurs de la possible hépatotoxicité du kava. Le kava a été interdit en 2002 dans les pays suivants : Allemagne, Australie, France, Canada, Irlande, Singapour, Suisse et Grande-Bretagne.
Plusieurs experts contestent la pertinence de ces interdictions étant donné que les rapports concernant la toxicité du kava seraient incomplets, mal documentés et qu'ils ne permettraient pas d'établir un lien direct avec la plante. En effet, dans plusieurs cas, les personnes touchées prenaient d'autres médicaments susceptibles de causer des troubles hépatiques, présentaient des problèmes de toxicomanie ou avaient des antécédents de troubles hépatiques11.
En 2005, les autorités médicales allemandes ont levé l’interdit complet qui frappait cette plante médicinale. Mais cette décision ne signifie pas que les consommateurs de ce pays pourront à brève échéance se procurer du kava. Cependant, des demandes d’autorisation de mise en marché peuvent de nouveau être prises en considération par les autorités médicales allemandes, tandis que depuis 2002, elles étaient rejetées a priori. Jusqu’à présent, la décision allemande n’a pas eu d’effet d’entraînement dans les autres pays où le kava est interdit. En 2011, une revue a de nouveau mis l’accent sur les effets toxiques du kava sur le foie (33).
Recherches
 Anxiété. Bien que le kava soit utilisé depuis des millénaires en Océanie, ce n'est qu'au début des années 1990 que des essais cliniques ont été menés. En 2003, les auteurs d’une revue systématique de 11 études (645 sujets), concluaient que l'extrait de kava est plus efficace qu'un placebo pour soulager l'anxiété diagnostiquée à l'aide d'outils médicalement reconnus1. En 2005, une autre méta-analyse regroupant six essais (345 sujets) menés en Allemagne sur un extrait spécifique de kava (WS 1490®, Schwabe Pharmaceuticals) sont arrivés aux mêmes conclusions. Ils précisent que la dose la plus efficace est de 300 mg par jour, ce qui, dans le cas de cet extrait normalisé à 70 %, correspond à 210 mg de kavalactones. Selon eux, les extraits normalisés de kava pourraient remplacer les benzodiazépines ou les antidépresseurs appartenant à la classe des inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS), particulièrement chez les patients dont le trouble anxieux est léger ou modéré2.
Anxiété. Bien que le kava soit utilisé depuis des millénaires en Océanie, ce n'est qu'au début des années 1990 que des essais cliniques ont été menés. En 2003, les auteurs d’une revue systématique de 11 études (645 sujets), concluaient que l'extrait de kava est plus efficace qu'un placebo pour soulager l'anxiété diagnostiquée à l'aide d'outils médicalement reconnus1. En 2005, une autre méta-analyse regroupant six essais (345 sujets) menés en Allemagne sur un extrait spécifique de kava (WS 1490®, Schwabe Pharmaceuticals) sont arrivés aux mêmes conclusions. Ils précisent que la dose la plus efficace est de 300 mg par jour, ce qui, dans le cas de cet extrait normalisé à 70 %, correspond à 210 mg de kavalactones. Selon eux, les extraits normalisés de kava pourraient remplacer les benzodiazépines ou les antidépresseurs appartenant à la classe des inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS), particulièrement chez les patients dont le trouble anxieux est léger ou modéré2.
Au cours de deux études de bonne qualité méthodologique, les effets du kava et ceux des benzodiazépines ont été comparés. Les résultats indiquent que les extraits de kava peuvent être aussi efficaces que cette classe de médicaments fréquemment prescrits dans les troubles de l'anxiété. La première de ces deux études, publiée en 1993, a duré six semaines et a porté sur 164 patients : une dose de 300 mg par jour d'un extrait standardisé (WS 1490®, fournissant 210 mg de kavalactones) s'est montrée aussi efficace que le bromazépam pour réduire l'état anxieux de patients. Publiée en 2003, la seconde étude a été menée auprès de 129 sujets suivis durant huit semaines : les participants ont pris soit 400 mg de kava (LI 150®, fournissant 120 mg de kavalactones), 10 mg de buspirone ou 100 mg d’opipramol durant huit semaines4. Des études menées sur de petits nombres de sujets indiquent par ailleurs que, chez des sujets en bonne santé, le kava ne provoque pas les effets indésirables causés par les benzodiazépines, notamment la diminution des facultés cognitives5,6.
Fait intéressant, le kava pourrait aussi faciliter le sevrage des benzodiazépines. Au cours d’un essai, 40 sujets ont reçu des doses croissantes de kava (jusqu'à 300 mg par jour de l'extrait WS 1490®) ou un placebo, tout en diminuant le dosage de leurs benzodiazépines sur une période de deux semaines. Les sujets ayant pris du kava ont vu leurs symptômes s'atténuer progressivement entre la première et la cinquième semaine de traitement, tandis que ceux du groupe placebo n'ont bénéficié d'aucune amélioration7.
Note. Un sevrage des benzodiazépines (diazépam® - Valium, lorazépam – Ativan® par exemple) doit être entrepris sous la supervision d'un professionnel de la santé.Quelques essais n’ont pas été concluants au chapitre du traitement de l’anxiété, ce qui peut s'expliquer par une qualité méthodologique qui laisse à désirer8, un nombre restreint de sujets9, ou une dose plus faible du produit WS 1490® (150 mg, fournissant 105 mg de kavalactones)10. On a également mené durant quatre semaines un essai à double insu auprès de 61 sujets souffrant d’insomnie causée par des troubles anxieux : une dose de 200 mg d’extrait de kava fournissant 140 mg de kavalactones (WS 1490®) a été plus efficace que le placebo12. Un essai préliminaire sans groupe placebo avait aussi donné de bons résultats13.
Par ailleurs, divers essais préliminaires indiquent que le kava peut être efficace chez des sujets en bonne santé souffrant d’anxiété reliée à la ménopause14,15, à l’attente des résultats d’une biopsie pour détecter un possible cancer du sein16.
 La Commission E allemande reconnaît l'usage du kava pour traiter l'anxiété, le stress et l'agitation. L’Organisation mondiale de la Santé reconnaît son emploi pour le soulagement à court terme de l’anxiété et de l’insomnie ayant pour origine un état nerveux ou stressé.
La Commission E allemande reconnaît l'usage du kava pour traiter l'anxiété, le stress et l'agitation. L’Organisation mondiale de la Santé reconnaît son emploi pour le soulagement à court terme de l’anxiété et de l’insomnie ayant pour origine un état nerveux ou stressé.
Bien qu'on ne connaisse pas encore très bien le mécanisme d'action du kava, des données in vitro et sur des animaux ont permis d’observer divers effets : antispasmodique, relaxant musculaire, analgésique, anticonvulsivant, sédatif et neuroprotecteur, notamment. Fait intriguant, le kava ne semble pas agir de la même façon que les médicaments ayant ce type d’effet. On a constaté que la plante a un effet sur le système limbique (partie du cerveau jouant un rôle dans les émotions)18. Au cours d’un essai sur les humains, les chercheurs ont observé que le kava avait un effet sur le nerf vague qui contrôle en partie la fréquence cardiaque19.
 Insomnie. Trois études cliniques auxquelles un faible nombre de sujets ont participé ont rapporté des effets sédatifs du kava. Ces effets doivent être confirmés sur des essais de plus grande envergure34,36. Une étude clinique randomisée entièrement menée via Internet a également donné des résultats non concluants : le kava (300 mg de kavalactones par jour) n’a pas été plus efficace qu’un placebo. Cette étude à double insu menée durant quatre semaines a porté sur 391 sujets souffrant d’anxiété et d’insomnie. Durant 28 jours, 135 sujets ont pris 640 mg d’un extrait de valériane (1 % d’acide valérinique), 121 ont pris un extrait de kava (300 mg de kavalactones), et 135 un placebo. L’amélioration du sommeil et la réduction de l’anxiété ont été substantielles, mais similaires dans les trois groupes11. Deux études avec la participation d’un petit nombre de patients ont également étudié les effets du kava (120 mg par jour pendant 6 semaines) sur les troubles du sommeil, seul ou en combinaison avec la valériane. Les auteurs ont rapporté un effet bénéfique de la valériane, mais soulignent que ces résultats doivent être confirmés sur un nombre plus élevés de participants38,39.
Insomnie. Trois études cliniques auxquelles un faible nombre de sujets ont participé ont rapporté des effets sédatifs du kava. Ces effets doivent être confirmés sur des essais de plus grande envergure34,36. Une étude clinique randomisée entièrement menée via Internet a également donné des résultats non concluants : le kava (300 mg de kavalactones par jour) n’a pas été plus efficace qu’un placebo. Cette étude à double insu menée durant quatre semaines a porté sur 391 sujets souffrant d’anxiété et d’insomnie. Durant 28 jours, 135 sujets ont pris 640 mg d’un extrait de valériane (1 % d’acide valérinique), 121 ont pris un extrait de kava (300 mg de kavalactones), et 135 un placebo. L’amélioration du sommeil et la réduction de l’anxiété ont été substantielles, mais similaires dans les trois groupes11. Deux études avec la participation d’un petit nombre de patients ont également étudié les effets du kava (120 mg par jour pendant 6 semaines) sur les troubles du sommeil, seul ou en combinaison avec la valériane. Les auteurs ont rapporté un effet bénéfique de la valériane, mais soulignent que ces résultats doivent être confirmés sur un nombre plus élevés de participants38,39.
 Stress. Une étude réalisée sur 54 participants en bonne santé ayant subi un test mental a montré que la prise de kava réduit la réaction du corps (caractérisée par une diminution de la pression systolique) au stress17.
Stress. Une étude réalisée sur 54 participants en bonne santé ayant subi un test mental a montré que la prise de kava réduit la réaction du corps (caractérisée par une diminution de la pression systolique) au stress17.
 Maladie de Parkinson. Une étude de cas révèle que l’extrait de kava WS 1490 réduit les effets secondaires extrapyramidaux provoqués par des neuroleptiques 40. Cela peut paraître contradictoire car il a été montré par ailleurs que le kava peut induire au contraire des effets moteurs de type parkinsonien20,41.
Maladie de Parkinson. Une étude de cas révèle que l’extrait de kava WS 1490 réduit les effets secondaires extrapyramidaux provoqués par des neuroleptiques 40. Cela peut paraître contradictoire car il a été montré par ailleurs que le kava peut induire au contraire des effets moteurs de type parkinsonien20,41.
Précautions
Attention
- Ne pas prendre de kava si on souffre de troubles hépatiques, si on prend des médicaments pouvant avoir des effets hépatotoxiques ou si on consomme de l'alcool sur une base régulière ;
- Consulter un professionnel de la santé avant de prendre du kava en cas d'antécédents de troubles hépatiques ;
- Ne jamais prolonger un traitement au kava au-delà de quatre semaines sans l'avis d'un professionnel de la santé ;
- Cesser immédiatement le traitement si des symptômes de jaunisse apparaissent : urine brune, yeux et peau jaunâtres ;
- Selon la Commission E, la durée du traitement ne devrait pas excéder trois mois sans la supervision d'un médecin ;
- Un cas de parkinsonisme associé à la prise de kava a été rapporté chez une personne ayant des antécédents familiaux de tremblement héréditaire20.
Contre-indications
- Troubles hépatiques ;
- Maladie de Parkinson ;
- Grossesse et allaitement ;
- Éviter de prendre du kava si on doit conduire un véhicule ou opérer de la machinerie.
Effets indésirables
Jusqu'en 2001, on considérait que le kava, aux doses habituellement recommandées, ne causait que peu ou pas d'effets indésirables. Par exemple, une étude de pharmacovigilance publiée en 1993 a porté sur 4 049 sujets ayant pris 70 mg de kavalactones par jour (soit une faible dose) durant sept semaines. On a relevé seulement 1,5 % de légers troubles gastro-intestinaux ou de légères allergies cutanées14. Les résultats d'une autre étude de pharmacovigilance portant sur 3 029 sujets ayant pris 240 mg de kavalactones durant quatre semaines révèlent que des effets indésirables semblables se sont produits dans 2,3 % des cas21.
Cependant, en 2001 et en 2002, une vague de rapports médicaux concernant des cas d'hépatotoxicité parfois très graves incite à la prudence, notamment dans le cas des personnes souffrant de troubles du foie22 (voir ci-dessus). Toutefois, plusieurs chercheurs estiment que les effets nocifs du kava sur le foie sont rares et doivent être confirmés par des données plus rigoureuses23-27. Selon un pharmacien allemand spécialiste du kava, les rares cas adéquatement documentés de toxicité hépatique sont liés à des extraits produits avec de l’acétone plutôt qu’avec de l’éthanol et tirés d’un cultivar inhabituel de la plante28.
Interactions
Avec des plantes ou des suppléments
- Les effets du kava pourraient s'ajouter à ceux d'autres plantes ayant des effets calmants ou sédatifs (valériane, passiflore, houblon, etc.). Il est conseillé de parler avec un professionnel de santé si l’on désire associer la prise de kava avec celle d’une autre plante.
Avec des médicaments
- Les effets du kava pourraient s'ajouter à ceux des médicaments ayant des effets sur le système nerveux central, notamment les benzodiazépines (diazépam® - Valium, lorazépam – Ativan® par exemple) et les barbituriques (Sécobarbital - Seconal®, par exemple) ou les antidépresseurs de type inhibiteur de la monoamine oxydase31. Ses effets sédatifs peuvent être exacerbés en présence de certains analgésiques (ex. oxycodone) ;
- Il est recommandé d’éviter de conduire lorsque l’on associe la kava avec des boissons alcoolisées ;
- Le kava pourrait augmenter les effets indésirables (mouvements soudains et involontaires) de certains médicaments antipsychotiques (prométhazine, halopéridol)31 et accroître l’intensité des vertiges provoqués par les antidépresseurs de type inhibiteur sélectif de recapture de la sérotonine (ex. fluoxétine, fluvoxamine et paroxétine) ;
- Le kava, par ses propriétés diurétiques, peut augmenter les effets de certains inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ex : benazépril). De plus, il ne doit pas être consommé en même temps qu’un autre diurétique (ex : acétazolamide) ;
- Le kava peut diminuer l'efficacité de la lévodopa, un médicament utilisé pour le traitement de la maladie de Parkinson entraînant ainsi une exacerbation des effets moteurs extrapyramidaux31 ;
- L’hépatotoxicité potentielle du kava (qui reste controversée cependant) pourrait être accrue si on combine l’extrait à l'un des nombreux médicaments ayant une action hépatotoxique (s’informer auprès d'un professionnel de la santé) ;
- Il est conseillé d’arrêter de prendre du kava deux à trois semaines avant une chirurgie, car cette plante peut prolonger les effets de l’anesthésiant ;
- Des données in vitro indiquent que le kava pourrait ralentir l’élimination de nombreux médicaments qui sont métabolisés par les enzymes de type CYP450 et donc augmenter leurs effets indésirables31. Cette interaction reste théorique, car à ce jour, on n’a signalé aucun cas qui permettrait d’en vérifier le réel effet clinique.
L'avis de notre pharmacien
Le 16 janvier 2002, Santé Canada émettait un avis concernant la sécurité du kava, des cas de toxicité hépatique ayant été rapportés. Le 21 août 2002, le Ministère bannissait complètement le kava sous toutes ses formes. Pourtant, la preuve de la toxicité de cette plante n’est toujours pas établie. En rendant sa décision, Santé Canada n’a publié aucune évaluation du risque réel ni aucune information sur les cas rapportés au pays.
Aucune preuve in vivo ne permet même d’expliquer le mécanisme de cette prétendue toxicité. De plus, dans la plupart des cas rapportés, les personnes atteintes avaient consommé des médicaments reconnus pour leurs effets toxiques sur le foie comme l’acétaminophène et le terbinafine. Également, aucune sérologie n’a été effectuée pour éliminer la possibilité d’une hépatite. Le cas d'une femme qui serait décédée après avoir pris du kava est particulièrement représentatif du manque flagrant de rigueur scientifique dans ce dossier. La dame en question était alcoolique et souffrait d’une cirrhose du foie diagnostiquée longtemps avant la prise du supplément23. En fin de compte, de tous les cas rapportés, seulement deux (peut-être trois) s’expliquent par un mauvais métabolisme du kava entraînant la formation d’un métabolite responsable d’une réaction de toxicité hépatique de type allergique. Cette réaction est réversible et ces trois personnes sont maintenant bien portantes.
Les Canadiens ne peuvent donc plus compter sur cet outil efficace contre les troubles d’anxiété et les autres états nerveux si fréquents de nos jours. Il existe cependant d’autres solutions de rechange aux médicaments sur ordonnance. Par exemple, la valériane, le houblon et la passiflore sont intéressants pour soulager l’anxiété et l’insomnie. Le millepertuis peut aussi être utile pour soulager des troubles à plus long terme. Toutes ces plantes médicinales bénéficient d’une documentation scientifique qui valide leurs effets sur le système nerveux.
Jean-Yves Dionne, BSc Pharm
-
 2
2
-
Bonjour
pour t'aider par rapport au sexe de tes plantes en l'etat actuel c'est pas possible (ou alors faut que je change mes lunettes ....), je ne vois pas sur tes photo de trichomes ou de paires de coucougnettes donc, attendre ....
J'ai juste une petite question par rapport à ta box croissance, je suis intrigué par la couleur rouge violette du spectre .... je suis en leds aussi, en croissance le spectre de mes leds tire plutôt sur le bleu blanc ...
Donc ma question est sur la lampe que tu utilises, est ce que c'est une lampe de croissance ou une lampe de flo utilisée en croissance ....???
@+

-
hello

Même principe, même recette ..... Tu met une variété CBD le beurre sera CBD. (ça marche aussi pour les ratios 1 pour 1 ....)
@+

-
 1
1
-










Chanvre en médecine edition 2017.
dans Discussion Thérapeutique
Posté(e)
Hey
https://www.hexagonevert.fr/boutique/livres/chanvre-en-medecine/
Chanvre en médecine : le Docteur Franjo Grotenhermen est un des docteur les plus connus de la lutte pour l’utilisation thérapeutique du cannabis en Europe.
D’origine allemande, chercheur à l’Institut Nova en Allemagne, il est également fondateur de l’IACM : l’Association Internationale pour le Cannabis Médicale, qui regroupe les spécialistes du sujet en Europe et organise régulièrement des conférences et des colloques sur l’utilisation du cannabis de façon thérapeutique.
@+